-
Bohuslav Martinu et ses dernières années à Bâle

Bohuslav Martinu (© universaledition.com)
Nombreux sont les compositeurs de l’entre-deux-guerres qui ont eu la chance de compter parmi les intimes de Paul Sacher, le milliardaire, chef d’orchestre, mécène et promoteur de la musique à Bâle et à Zurich (voir A.Honegger, B. Bartok ou V. Vogel). Tel Bohuslav Martinů dont le contact avec Sacher remonte à 1929 lors d’un concert à Paris. Sa femme Charlotte évoque leur première visite de 1938 à Bâle où Sacher les a logés dans sa villa ‘Schönenberg’ située à la lisière d’une forêt près de Pratteln :

Schönenberg
« Cette maison était pour lui une oasis de compréhension, d’harmonie, de chaleur, de silence et de beauté. » Les conversations avec le couple Sacher et le charme de la forêt proche semble avoir comblé notre compositeur, sans parler de la bibliothèque privée copieusement dotée dont Martinů, lecteur passionné, pourra largement profiter. – Et c’est là qu’il achève en 1938 son Double concerto pour deux orchestres à cordes, piano et timbales H. 271, une œuvre trépidante où le mitraillage ininterrompu des doubles croches semble propulser un thème syncopé et fugué aux intervalles serrées (Poco Allegro). L’Adagio par contre s’ouvre sur un choral solennel à l’allure chromatique, le cantus firmus étant confiné à l’intérieur de la tierce mineure :

Paul Sacher va créer ce double concerto avec son orchestre de Bâle en 1940, après le départ de Martinů pour l’Amérique.
Au bout d’une période d’instabilité (séjours en Amérique, en France et à Rome) le couple Martinů revient en Suisse, invité en 1957 par la pianiste Margrit Weber de Zurich. C’est pour elle que Martinů écrira – de nouveau installé chez les Sacher à Schönenberg – son 5e Concerto pour piano en si-bémol majeur appelé ‘Fantasia Concertante’.

Martinů et Margrit Weber 1957 en Suisse (dom. public)
Une fois de plus Martinů vient se ressourcer auprès des musiciens du folklore de son pays d’origine quand, dans le 1er mouvement, il fait suivre le jeu fébrile initial par le chant hymnique syncopé aux harmonies slaves :

Après le martèlement des mesures finales le Poco andante nous emmène vers un vaste panorama collineux évoqué par une succession d’harmonies romantiques majeurs, entrecoupées de rares dissonances de transition (souvenir de son pays – ou idylle champêtre autour de Schönenberg ?). Margrit Weber va créer ce concerto l’année suivante à Berlin sous Ferenc Fricsay.
Quant au compositeur versé dans la littérature il nous a laissé une œuvre charmante commencée à Rome et achevée à Bâle : Les Paraboles, un morceau orchestral doté d’une puissante percussion. Les deux premiers éléments renvoient à ‘La Citadelle’ de St-Exupéry : parabole du sculpteur et parabole du jardin. Charles Munch, son ami de longue date et dédicataire de l’œuvre la présentera en 1959 avec le Boston Symphony Orchestra. La tonalité du 1er mouvement (Andante pastorale) dominé par les cors et les bois rappellent de près le lyrisme dvořakien, un chant bucolique escorté cependant par l’agitation serrée aux frictions harmoniques inattendues, un renvoi aussi à Debussy (dont Martinů s’était autrefois émancipé) par ces accords parallèles délimités entre la sixte et la quinte et garni d’un intervalle de seconde :

Les accords parallèles à la Debussy
L’année 1958 à Schönenberg s’avère extrêmement fructueuse : en 4 semaines seulement Martinů compose Ariane, l’opéra en 1 acte d’après ‘Le Voyage de Thésée’ de Georges Neveux. Contrairement à l’Ariane de Monteverdi où la princesse abandonnée par Thésée se soit dédommagée sous peu par l’arrivée de Bacchus qui lui promet le bonheur éternel parmi les dieux, celle de Martinů, convoitée de part et d’autre par Minotaure et par Thésée, assiste au spectacle quasi surréel où Minotaure figure l’alter ego de Thésée, ayant pallié l’attaque de ce dernier qui reprend le large devant Crète, laissant une Ariane inconsolable sur la rive et dont la plainte à grandes vocalises (conçue pour Maria Callas) représente la partie-clé de l’opéra, un aria aux antipodes de la ‘sinfonia’ initiale dont la structure quasi ‘simpliste’ a évoqué une danse folklorique de type grec. Ariane envoie un « adieu » languissant en direction de son Thésée disparu, sur une note tenue qui s’évanouit au-dessus des accords qui s’approchent en rampant pour retrouver le sol-majeur, avant de faire éclater en écho la danse initiale de l’opéra.

Nikos Kazantzakis en 1953 Nikos Kazantzakis 1956 (dom. publ.)
Lors d’un de ses séjours nombreux au-dessus de Nice, dont Charlotte vante la splendeur du paysage méditerranéen, Bohuslav tombe un jour sur un roman qui le fascine à tel point qu’il se propose d’en faire un opéra : ‘Alexis Sorbas’ – histoire de contacter son auteur qui habite également à Nice : Nikos Kazantzakis. Leur conversation s’envole immédiatement vers des horizons philosophiques et Martinů est profondément touché par l’esprit d’humanité de l’écrivain. Ce dernier propose au compositeur son roman ‘Le Christ recrucifié’dont la traduction anglaise lui permettra d’écrire un libretto, un projet qui va évoluer et mûrir pas à pas, au rythme de leurs entretiens de Nice.
The Greek Passion
(le Christ recrucifié)

Après la 1ère guerre mondiale l’expansion de la Grèce est brutalement réprimée par la Turquie nouvellement fondée et l’action se situe au début des années 1920, lors de la guerre gréco-turque. Dans la partie non-occupée le village Lykovrissi s’apprête à planifier la mise en scène du jeu de la passion du Christ pour l’année prochaine. Le pope Grigoris, en tant qu’autorité du lieu, se met à distribuer les rôles, tout en exhortant ses fidèles à intérioriser le caractère de leur protagoniste dans leur quotidien. Si le forgeron Panaïs se montre récalcitrant à l’égard de son rôle de Judas, le berger Manolios se sent honoré de représenter le Christ, mais indigne de porter la croix. La jeune prostituée Katerina est comme prédestinée pour jouer le rôle de Marie-Madeleine. – Les préparatifs vont bon train lorsque surgit une file de réfugiés d’un autre village en fuite devant l’assaut des Turcs. Que faire ? Panaïs tâche de les refouler, mais Katerina se montre solidaire avec la pauvre cohorte menées par le prêtre Fotis qui explique à nos villageois pris au dépourvu les raisons de leur fuite. De son côté le pope Grigoris lance ses invectives contre les intrus, prétendant que la femme épuisée qui vient de s’effondrer leur portait le choléra, qu’en somme ses voisins avaient sûrement péché et qu’ils en portaient les conséquences. La présence des réfugiés va bousculer la vie sociale et diviser notre village : Ladas, le doyen, propose de leur offrir des vivres à des prix exorbitants, tandis que Manolios offre aux réfugiés une place au pied de la montagne, en prêchant devant les indifférents la miséricorde, en renonçant à l’amour pour sa fiancée pour se consacrer entièrement à sa mission. Mais la fraction xénophobe du village prend le dessus et après son dernier sermon devant l’église Manolios sera abattu par Panaïs (le ‘Christ recrucifié’), Grigoris l’ayant défini comme un lépreux, comme ‘brebis malade’ qu’il fallait éliminer pour ne pas contaminer le troupeau. Entretemps la belle Katerina, transfigurée sous l’aura du bienfaiteur Manolios, s’est muée en bienfaitrice : la prostituée est devenue ‘Sœur Thérèse’, érigeant avec quelques amis solidaires un rempart de protection pour les réfugiés contre la xénophobie ambiante.
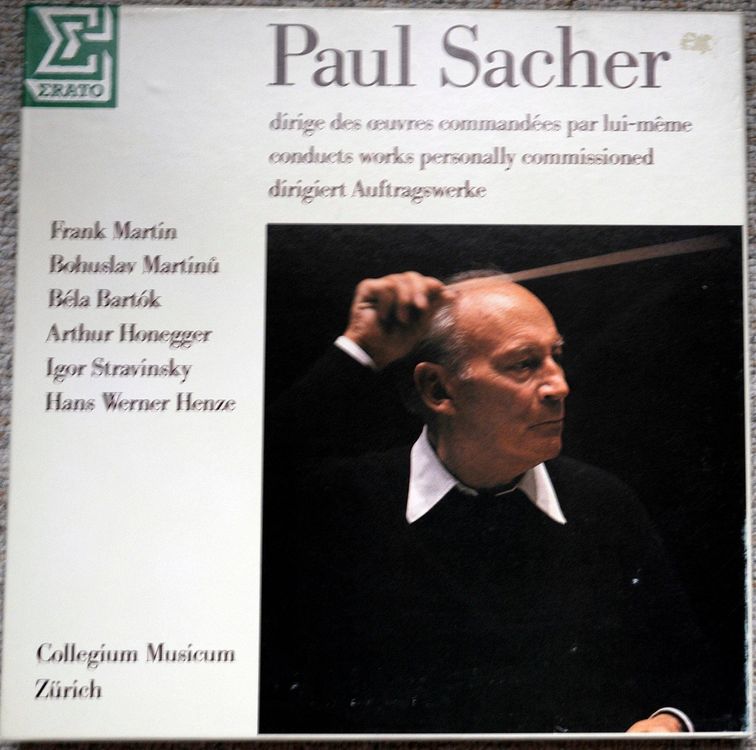
La création de Greek Passion sous Raphael Kubelík à Londres est annulée par Covent Garden, l’œuvre étant surchargée de numéros parlants ou de récitatifs, sur quoi Paul Sacher invite son ami à condenser son opéra et Martinů en sortira une version ‘dépurée’ où les longs discours sont éliminés au profit de l’arioso. Judas (Panaïs) sera l’unique rôle parlé, le malfaiteur ne devrait pas avoir accès à la musique. – Cette nouvelle version sera créée en traduction allemande peu après la mort du compositeur au Théâtre de la ville de Zurich en juin 1961 sous la direction de Paul Sacher (et la version originale de Londres sera reprise en 1999 lors du Festival de Bregenz sur le Lac de Constance).
Sur la plan musical Martinů revient au discours diatonique, même ici dans une de ses dernières œuvres. Les parties du chœur (des réfugiés) prennent un ton hymnique, souvent à l’unisson et au fond sonore sobre issu de la musique sacrée byzantine, parfois comme discours du genre grégorien, sans parler du clin d’œil à la Renaissance italienne que Martinů aimait tant. D’autre part nous assistons à des scènes de fête où dominent soit des mélodies grecques soit des rythmes tchèques. Quant aux leitmotifs Martinu en introduit essentiellement trois :
- Dans les premières mesures de l’introduction nous entendons un hymne de caractère ecclésiastique qui surgira plus tard dans les moments d’introspection et de réflexions graves :

2. Le motif de la croix : La courbe sinueuse de demi-tons, issue des ‘lamentations’ dans la musique baroque, avant tout chez Bach (voir aussi l’anagramme B-A-C-H et le thème de ‘L’Art de la Fugue’), trouve ici son équivalent dans de nombreux passage à caractère de récitatif, comme p.ex. là où Grigoris charge Maniolios d’assumer le rôle du Christ (et de porter la croix), mais de façon plus expressive ancore dans la plainte de Despinio, la femme exténuée qui s’écroule en arrivant avec les réfugiés :
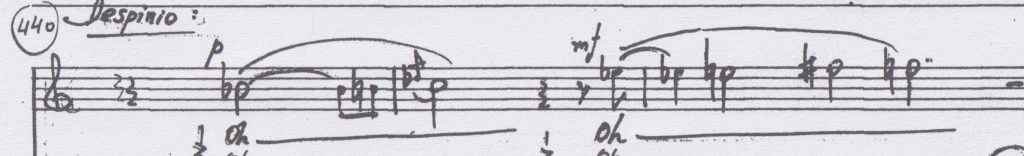
Despinio : son cri avant de mourir
Ce motif traverse comme un fil rouge les 4 actes : Dans la prière des villageois, dans le chœur des réfugiés, dans la confession de Manolios lors de son dernier prêche et – après que le mob l’a assassiné – dans le chant funèbre de Katerina : « Le nom du jeune homme, inscrit dans la neige fondue maintenant, s’est écoulé dans la mer, avec toutes les eaux. » :

Le 3e motif caractérise le processus de purification chez Katerina, une courbe ascendante, syncopée, évoqueé périodiquement par les voix aigües de l’orchestre et soutenue par la sixte :

Le moment où Manolios frappe à la porte de Katerina et séduit par elle qui va l’implorer de la sauver, l’appelant son ‘rédempteur’.
Manolios résiste à la séduction et se retire sous l’accompagnement d’une valse-musette à l’accordéon. Et le motif de Katerina réapparait après que la prostituée – sous l’emprise ‘divine’ de Manolios – a fait pénitence pour ses péchés, prête à offrir son unique chèvre aux réfugiés. – Et le dernier rappel du motif: comme épilogue aux paroles de Manolios qui explique à la communauté sa mission du Christ, en disant que Dieu agit en silence, qu’Il ne connaît pas de hâte. – L’opéra se conclut par le chant sinueux à l’unisson d’un « Kyrie eleison » dont les réfugiés refoulés accompagnent leur départ vers l’inconnu.
Les dernières années de Martinů à Schönenberg sont ombragées par son cancer qui progresse. Plus la mort approche plus le compositeur porte dans son for intérieur les rêves des collines de la Bohême, de Brno (le pivot de sa jeunesse), de son village Policka, des danses tchèques…Ses dernières compositions à Schönenberg en sont fortement imprégnées. A son ami Miloš Šafránek de Prague il confie dans une lettre peu avant sa mort : « Ce qui m’a sauvé, c’est qu’au fond je suis un homme du peuple. » A retenir ici l’œuvre vocale Mikesch vom Berge, les Variations sur un thème slovaque pour violoncelle et piano, les Madrigaux pour chœur mixte sur des poèmes de la Moravie écrits pour son village natal, La Fête des Oiseaux pour le chœur d’enfants de Brno – et le fameux Nonette à l’intention du 35e anniversaire du Nonette Tchèque, l’œuvre que son biographe Harry Halbreich définit comme son ‘testament en musique de chambre’, la musique ‘la plus tchèque’ selon lui. – Dans le Poco Allegro Martinu nous entraine dans le tourbillon d’une danse champêtre au rythme binaire fortement percussif, mais en filigrane nous percevons une mélodie relayée d’un instrument à l’autre :

la mélodie jouée ici par le basson
La suavité de l’Andante évoque la beauté de la Bohême, mais des sonorités stridentes semblent corroborer l’idylle – l’imminence de la mort ? – Le caractère jubilatoire ouvre l’Allegretto finale, une autre danse aux mesures changeantes entre le binaire, le ternaire et le 5/8.

la danse allègre confiée ici à l’hautbois
Le site de Schönenberg au-dessus de Pratteln comprenait autrefois plusieurs bâtisses. Dans l’une des maisons voisines de la villa habite Adrian, un garçon de 11 ans qui se souvient de ses ‘aventures’ en compagnie de ‘Monsieur Martinů’ : comment il l’a accompagné dans les promenades en forêt, avec quelle discipline le compositeur a soigné son potager pour y récolter quelques asperges, comment il s’est fait conduire à Bâle dans la Rolls Royce noire des Sacher pour faire les courses ou alors pour se prélasser au Café du Casino autour de son verre de Chartreuse, quels étaient ses rapports complices avec le chien et le chat de la famille etc.
Au seuil de la mort Martinů a désiré de célébrer encore les noces religieuses, ce que le curé de Liestal a bien voulu accomplir. L’agonie à la clinique de Liestal durait plusieurs jours. Charlotte nous en laisse un témoignage bouleversant : « A deux heures du matin il a dit : ‘J’aimerais une injection maintenant, puis dormir’ – et après : ‘Embrasse-moi. Nous ne nous quitterons jamais’ – et je savais que c’était le dernier baiser. »
Bohuslav Martinů était d’abord inhumé sur le site privé de Pauls Sacher à Schönenberg, mais sa dépouille a été transférée plus tard à Policka, son lieu d’origine.

La tombe de Bohuslav Martinů
S O U R C E S :
Charlotte Martinů, Mein Leben mit Bohuslav Martinů, Orbis, Prague 1978
Harry Halbreich, Bohuslav Martinů, Atlantis Verlag, Zurich 1968
Rudolf Pecman, Martinůs Bühnenschaffen, Prague 1967
F. James Rybka, Bohuslav Martinů, The Compulsion to Compose,
Scarecrow Press, Lanham (USA), 2011
Robert C. Simon, Bohuslav Martinů, a research and information guide,
Routledge, New York/London 2014
Bohuslav Martinů, Griechische Passion, éd. allemande pour la création de 1961 à Zurich, Universal Edition, facsimilé de la partition (réduction pour piano) dont les extraits ici
D I S C O G R A P H I E – Y O U T U B E S :
Double concerto pour 2 orchestres et piano : Boston Symph. Orchestra + Rafael Kubelík (audio de 1967)
Radom Chamber Orchestra+Beethoven Academy Orchestra + M. Zóltowski (film de 2012)
Orchestre philharmonique de Prague + Charles Mackerras (avec partition syncronisée – 1982)
5e Concerto pour piano : Margrit Weber et l’orchestre symphonique de la radio bavaroise + Rafael Kubelik – 1965 (audio)
Emil Lechner et l’orchestre philharmonique tchèque + JiřÍ Bělohlávek (tous les 5 concertos – audio)
Les Paraboles : Orchestre philharmonique tchèque + Karel Ančerl 1961 (audio)
Orchestre philharmonique tchèque + Jiří Bělohlávek (audio)
Ariane : Orchestre philharmonique tchèque + Vaclav Neumann (audio)
Schweizerisches Opernstudio Bienne – projet 2016 (film)
The Greek Passion : Orchestre symphonique de Vienne, Chaber Choir de Moscou + Ulf Schirmer : 1ère version en anglais au Festival de Bregenz (film) 1999
Orchestre philharmonique de Brno, chœur philharmonique de Prague + Charles Mackerras : 2e version en anglais (très beau film sur DVD) 1999
Nonette : Ensemble Vienne-Berlin 1988 (avec partition synchronisée)
Festival Concert Hall, Chamber Music Concert 2017 (film)
-
Ernest Bloch – compositeur juif de Genève, citoyen américain

Ernest Bloch à Bruxelles 1. A n n é e s d’ a p p r e n t i s s a g e
Né en 1880 à Genève le petit juif se fait tabasser dans une cour scolaire, sa revanche : La maîtrise du violon, le moyen de se faire respecter. Fasciné par le jeu d’Eugène Ysaÿe en tournée à Genève le jeune musicien de 19 ans va le rejoindre aussitôt à Bruxelles pour se ranger parmi les élèves du plus grand violoniste de l’époque. L’instrument seul ne lui suffit toutefois pas, c’est la composition qui suscite son enthousiasme, si bien qu’il se confie à César Franck, se perfectionnant par la suite auprès des maîtres de Francfort et de Munich. Sa 1ère symphonie écrite à 22 ans dans la capitale bavaroise révèle à quel point Richard Strauss l’a séduit (à côté de Gustav Mahler). – Prochaine étape, nouvelles rencontres : Paris. Grand admirateur de « Pelléas et Mélisande », l’opéra qu’il place au-dessus de celles de Wagner, Bloch discute avec Debussy sur le message de la musique française après le tapage autour de Wagner et les adeptes de la « Wagnériana ». – Son ami parisien Edmond Fleg lui propose un livret du drame de « Macbeth » de Shakespeare – et Bloch se lance dans le projet, mais faire jouer son opéra à Paris s’avère une entreprise pleine d’entraves. – Fleg sera d’autre part à l’origine de sa « révélation juive » avec la traduction de 3 psaumes qui déclenchent chez Bloch une fascination pour la matière biblique, fascination non seulement pour le message, mais aussi pour la poésie du Vieux Testament. – Dans le Psaume 114 sur l’exode de l’Egypte il fait résonner parmi les cuivres le schofar (la corne du bélier – instrument rituel du sabbat), et dans le Psaume 22 la voix du soliste s’élève avec son « Elohim, Elohim, pourquoi m’as-tu abandonné ? » :
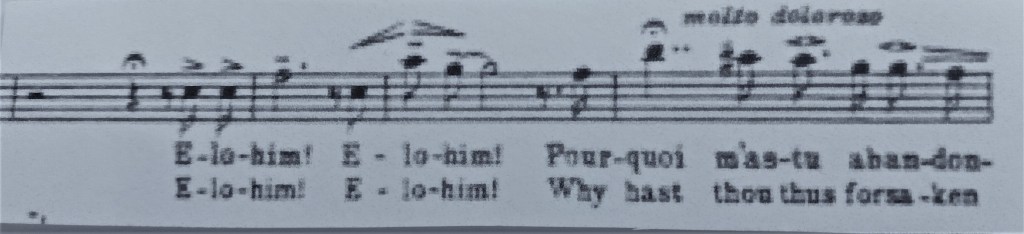
Dans le Psaume 137 nous voyons le désespoir du peuple juif séquestré comme otages à Babylon, se lamentant au bord du fleuve : Comment vénérer Dieu si loin de notre temple ?

Les hébreux exilés à Babylon dans leur désespoir (18e s., anonyme – dom. public)
De retour à Genève Bloch continue ses méditations juives : une œuvre tripartite intitulée Trois Poèmes Juifs, dont la musique nous emmène dans un monde oriental avec le célesta, la harpe, les arabesques mélodiques et les trémolos des cordes, le son du schofar compris.
Pour parfaire les créations de cette période Bloch écrit sa 2e symphonie :
ISRAËL – SYMPHONIE (1912-1916)
Il s’agit, selon ses propres dires, d’une « synthèse de l’âme juive » : le peuple passe de la confession lors du Yom Kippour (timbales et dissonances, les coups douloureux du « mea culpa ») au repentir, avant de chanter la prière du pardon à travers les lignes de tendresse dans les bois :
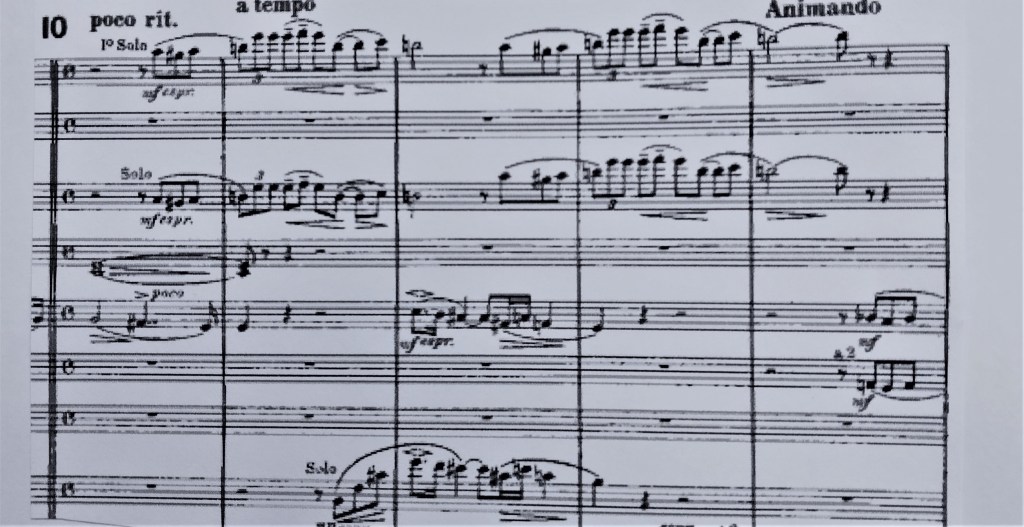
Prière du pardon (flûtes et hautbois)
La partie du « Souccot » prépare le terrain au soliste de la basse avec son « Adonaï… », pendant que le chœur flotte – comme celui des « Sirènes » de Debussy – sur ses vocalises ondoyantes. – La finale devrait aboutir à un hymne de la paix universelle, une sorte d’écho à l’ »Ode à la joie » de Beethoven, mais la guerre de 1914 va saccager cette vision.
SCHELOMO – Rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre (1916)

La pièce la plus populaire de Bloch remonte à son aimitié avec le violoncelliste ukrainien Serge Barjansky et sa femme qui, elle, vient de sculpter la figurine du roi Salomon, en suggérant au compositeur d’en faire une œuvre orchestrale.
Le violoncelle (la voix du roi) surgit d’un lointain horizon sur son « la » prolongé et isolé, avant de s’engager dans un discours méandrique, mouvementé, autour de la cellule rythmique du più animato :
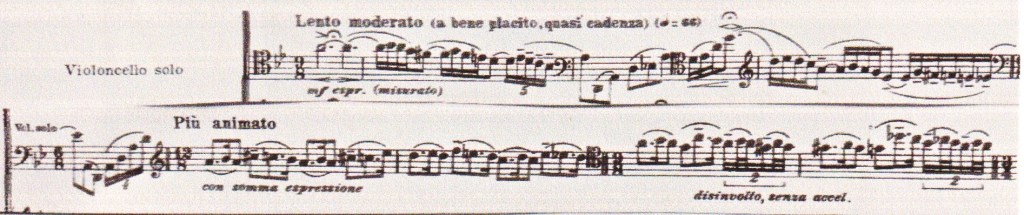
L’orchestre (le peuple) traverse des moments dramatiques, mais le soliste sait calmer les esprits et boucle la pièce en dégringolant jusqu’au Ré profond de son instrument, sur un ton de résignation qui relève de la sagesse de Salomon, selon laquelle « tout est vanité ».
2. E n A m é r i q u e (1917 – 1930)
Depuis le concert du 3 mai 1917 au Carnegie Hall de New York consacré exclusivement aux œuvres d’Ernest Bloch, notre compositeur sera dorénavant défini comme musicien juif. Immigré en compagnie de sa famille la même année Bloch déambule dans les quartiers orthodoxes, s’il n’est pas en tournée à travers les Etats-Unis.
Un premier Quatuor à cordes donne de nouveau dans la matière juive et les critiques soulignent que la musique de Bloch n’est pas une adaptation du folklore juif, mais l’expression de l’esprit et de l’âme juive. – L’institut de Musique de Cleveland lui offre le poste de directeur et Bloch s’engage dans une carrière de professeur et d’administrateur, tout en publiant des articles sur la pédagogie musicale. Parmi les nouvelles compositions il revient sur la matière juive :
BAAL SCHEM (trois tableaux de la vie hassidique) (1923)

la maison « Baal Schem » en Ukraine Cette œuvre pour violon et piano rappelle les messages du fondateur du mysticisme hassidique Baal Schem Tov du 17e siècle et se divise en trois parties : Vidui – la prière de pénitence, Nigun – une chanson hassidique, et Simcha Torah – la fête de la Loi reçue au Sinaï, ici comme danse selon une chanson yiddish. Yehudi Menuhin, encore adolescent, découvre les charmes de cette musique et joue souvent Nigun en pubic. C’est le début d’une amitié de la famille Menuhin avec le compositeur (Yehudi Menuhin dirigera son Avodath Hakodesh bien après la mort du compositeur).
L’année suivante Bloch rencontre Pablo Casals en tournée en Amérique et lui dédiera deux pièces pour violoncelle et piano :
MÉDITATION HÉBRAÏQUE et FROM JEWISH LIFE
Prayer – comme extrait de « from jewish life » – sera la pièce la plus souvent jouée du cycle, une mélodie judéo-slave de tonalité profondément mélancolique :
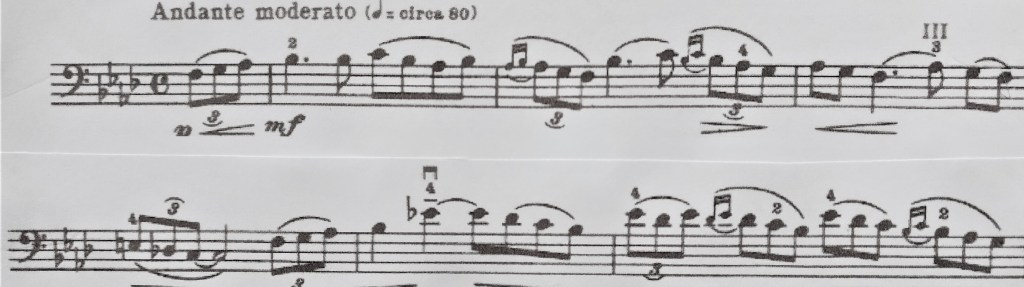
Prayer (violoncelle)
3. R e n t r é e e n S u i s s e
Citoyen américain depuis 1924 Ernest Bloch se retrouve à la tête du Conservatoire de San Francisco (après Cleveland) et depuis sa nouvelle pièce America-Rhapsody de 1926 la presse le considère comme le plus grand compositeur américain de l’époque (à côté de Georges Gershwin). Ses œuvres sont jouées partout dans le monde, et dans sa correspondance il évoque minutieusement lieux et dates de ces exécutions. Contacté par le chantre de la grande synagogue de San Francisco qui lui demande une musique synagogale Bloch se propose de créer un oratorio pour le service du sabbat. Mais d’abord il s’agit d’apprendre la langue hébraïque, si possible dans un lieu retiré du monde. Pourquoi pas revenir en Suisse ? Après quelques mois d’austérité dans une cabane des Alpes bernoises il trouve une grande bâtisse sans confort dans un village isolé aux alentours de Lugano : Roveredo, le hameau d’une vallée tessinoise.

maison et jardin de Bloch situés à la « Via Ernest Bloch » à Roveredo, vue vers le Lac de Lugano au sud (photo J. Zemp) C’est là qu’il va se consacrer à la composition de son œuvre pour baryton (le chantre), chœur (les fidèles) et orchestre, un oratorio en cinq mouvements selon les cinq parties du rite sabbatique, le texte de Bloch rédigé en hébreu ashkénaze, avec une version en hébreu séfarade pour les pays méditerranéens.
AVODATH HAKODESH – SACRED SERVICE/SERVICE SACRÉ
Méditation – avec une courbe mélodique introductive dans le registre des basses : Sol-La-Do-Si-La-Sol – pour accompagner l’ouverture du tabernacle.
N’Kadesh – sanctification
Silent Devotion – sortie des rouleaux et accompagnement du rite
Torah tziva – les rouleaux sont ramenés au tabernacle
Adoration – Va’anahnu – adoration et kaddis

plaque commémorative à l’entrée du jardin à Roveredo (photo J. Zemp) La musique frappe par ses quartes et quintes parallèles, ses ostinati, le pas d’un ton et demi fréquent, mais les sources d’inspiration sont multiples : du chant grégorien à la musique vocale de la Renaissance, des chants de la synagogue aux grandes messes de l’époque classique – et dans la 1ère partie méditation la voix du baryton s’élève au-dessus des accords homophones du chœur, comme un souvenir lointain de l’œuvre vocale de Mendelssohn.

Le compositeur avec la partition de « avodath hakodesh » (©Lucienne Allen)
La création du 11 avril 1934 au Carnegie Hall à New York suscite des réactions controverses, tandis qu’elle est saluée avec enthousiasme en Italie.
Ernest Bloch va quitter le Tessin (trop bruyant !) pour aller se terrer à Châtel, un hameau dans les Alpes savoyardes où il se ressource pendant les randonnées et par la lecture des romans mythiques de Jean Giono, en correspondant avec l’écrivain de la Haute Provence.

le hameau de Châtel à l’époque Mais face à la montée du nazisme et à la guerre imminente Bloch quitte l’Europe en 1939, ses partitions ayant figuré parmi les « œuvres dégénérées » en Allemagne lors de la fameuse exposition « Entartete Kunst » (en compagnie de Mahler, Weill, Schönberg et bien d’autres).
4. R e t o u r e n A m é r i q u e
L’université de Berkeley offre à notre compositeur un poste d’enseignant et d’administration, une charge qui s’avère lourde. En plus le sexagénaire traverse des crises psychiques, ce qui le pousse à trouver un refuge ailleurs. A Agate Beach, au littoral de l’Oregon, il va passer ses jours de repos. La vie campagnarde lui fait du bien : tailler des bûches et trouver des billes de qualité à la plage le réjouissent autant que la musique.
Après un nouvelle incursion en Suisse pour des raisons de santé (séjour en Engadine) il se rend à Chicago pour y recevoir les honneurs que la ville lui offre pour ses 70 ans : ce « Festival Bloch » de 1950 va couronner sa carrière américaine (série de concerts pendant une semaine, interviews, articles de presse, banquet d’honneur…).

son discours lors du banquet d’honneur (© Lucienne Allen) Les dernières années d’Ernest Bloch seront de plus en plus assombries par la maladie. Les séjours de repos à Agate Beach se multiplient. Malgré le dépérissement de ses forces il réussit à composer encore : Dans la Suite hébraïque pour alto et piano de 1951 il met le chant rhapsodique du début en parallèle de quinte entre l’alto et le piano – et la Symphonie pour trombone (violoncelle) et orchestre de 1954 est considérée comme « pendant » à son fameux « Schelomo ». L’évocation du schofar sera articulée de façon persistante dans la Proclamation pour trompette et orchestre de 1955, sa dernière pièce d’inspiration juive, une « confession de foi » , tel son commentaire.

Les sauts des quintes et quartes figurant les sons du schofar
Les toutes dernières œuvres ne relèvent plus des racines juives : Son ami Yehudi Menuhin lui demande 2 suites pour violon seul, et à Zara Nelsova Bloch va dédier 3 suites pour violoncelle. La Suite pour alto de 1958 s’appuie sur les structures des partitas pour violon seul de J.S. Bach.


Menuhin ©Warner Classics En 1959 notre citoyen suisse-américain, ami de tous les grands interprètes de son époque, correspondant infatigable, pédagogue renommé – et somme toute un géant de la musique juive s’éteint à l’hôpital de Portland, entouré de ses filles, à qui il demande une dernière lecture sur son lit de mort : « Le Malade Imaginaire » , preuve de son humour grinchant !
Ses cendres seront dispersées dans les vagues près d’Agate Beach et une plaque commémorative sera apposée à la rive, avec le portrait du « promeneur solitaire » à la pipe.
L’article wikipedia sur « Agate Beach » en anglais évoque « his most famous citizen Ernest Bloch », en signalant la « Ernest-Bloch-House » comme faisant partie des « historical places ».

E. Bloch à la rive du Pacifique près d’Agate Beach (©Lucienne Allen) Bloch à la rive du Pacifique près d’Agate Beach (©Lucienne Allen)
S O U R C E S :
Joseph Lewinski et Emanuelle Dijon, Ernest Bloch – sa vie et sa pensée, Vol. 1-4, éd. Slatkine Genève 1998 – 2005
Matériaux publiés par la « Ernest-Bloch-Society »*
Contact personnel avec Lucienne Allen vivant en Californie, l’arrière-petite-fille du compositeur
*La « Société-Ernest-Bloch » anglo-américaine fondée en 1937, dont Albert Einstein avait la présidence de la section londonienne, dispose d’archives volumineux et organise régulièrement des concerts et des colloques. Son président actuel est Steven Isserlis.
E n r e g i s t r e m e n t s :
Les oeuvres d’inspiration juive d’Ernest Bloch sont toutes disponibles sur CD.
Parmi les vidéos notons les youtubes suivants :
- Israël-Symphonie avec Dalia Atlas et l’orchestre de la radio slovaque (audio)
- Quatuor à cordes 1 avec le Portland Quartet (avec partition à suivre)
- Méditation hébraïque avec Christoph et Marc Pantillon (film)
- Prayer avec Sol Gabetta 2011 (film)
- Suite hébraïque avec Arianna Smith (film)
- Symphonie pour trombone avec le Portland Youth Philharmonic (audio)
- Avodath Hadkoesh avec Lenoard Bernstein et le New York Philharmonic (disque)
- avec Ernest Bloch et le London Philharmonic 1949 (dlisque)
-
Louise Farrenc – musicienne romantique et pionnière

Dès 1802 le complexe de la Sorbonne héberge une trentaine de familles d’artistes de tout genre, évacuées du Louvre où elles jouissaient autrefois des privilèges de la Cour et logées ici par Napoléon qui s’emparait du Louvre pour y exposer ses trophées. Ainsi la famille de Jacques-Edme Dumont, suclpteur renommé et père de Louise – la future musicienne – et d’Auguste, sculpteur comme son père.

Les appartements des artistes à la Sorbonne au début du 19e siècle (©Musée Condé)
Louise Dumont naît le 31 mai 1804 et révèle très tôt son talent pour la peinture. En connaisseurs de l’art les parents veillent à une éducation culturelle approfondie pour leurs enfants. C’est que la tradition de l’Ancien Régime où la progéniture aristocratique passait sa jeunesse dans les institutions religieuses est révolue. La bourgeoisie tient à consolider le noyau familial et l’amour des parents veille sur la voie de leurs enfants. Quant aux filles les idées traditionnelles ont toujours leur impact : L’adolescente n’a pas besoin de connaissances scientifiques pour remplir plus tard son rôle de femme au foyer. – Grâce à la générosité des Dumont la jeune Louise aura le droit d’approfondir le français et les langues étrangères et d’acquérir une culture générale. On tient compte de son penchant pour la musique et les parents la confient à Anne-Élisabeth Soria, une pianiste de marque, ancienne élève de Muzio Clementi. Les progrès de son élève brûlent les étapes, si bien qu’à 15 ans Louise ressent un besoin impérieux de connaître la théorie de l’harmonie. Antone Reicha est sans doute la première adresse dans ce domaine. D’origine pragoise Reicha est nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris en 1818. Puisque les universités et les conservatoires ne sont pas encore ouvertes aux femmes, Louise Dumont a la chance de suivre en enseignement privé auprès du professeur Reicha (composition, contrepoint, orchestration…). Le piano n’est pourtant pas négligé – au contraire : Le milieu éclairé de la Sorbonne lui occasionne des entrées sur scène comme soliste ou comme chambriste. Un jour elle exécute un concerto de Dussek, suivi par un concerto pour flûte joué par le jeune flûtiste Aristide Farrenc. Affaire conclue : Les deux musiciens vont se marier le 29 septembre 1821. La jeune épouse de 17 ans a la chance de vivre à côté d’un mari de 27 ans qui fera tout pour soutenir la femme dans sa future carrière. Comme éditeur il saura diffuser les compositions de son épouse déjà à partir de 1824 où vont sortir les opus 2 et 4 : Les Variations brillantes sur un thème d’Aristide Farrenc op. 2 de la compositrice de 20 ans s’annoncent par un geste de grandiloquence lisztienne avant d’articule un thème simpliste dont elle sait tirer des variations où la main droite est propulsée sur un course époustouflante de doubles croches, histoire de faire briller la virtuosité de la pianiste, ce qui marque de toute façon les première années de son mariage, soit sur les plateaux soit en milieu privé. Les critiques lui attestent « un talent fort distingué », et l’on apprécie sa réserve vis-à-vis de la virtuosité mécanique : « Elle a suivi la route tracée par Hummel (dont elle aime jouer les œuvres de chambre), Moscheles, Kalbrenner, et paraît destinée à y obtenir d’honorables succès. » Et Marmontel, le futur professeur au Conservatoire de remarquer plus tard : « Mme Farrenc n’était pas une virtuose transcendante dans l’acceptation stricte du mot, mais une pianiste de style, commandant l’attention par sa manière magistrale de comprendre et d’interpréter (…). Conviction, éducation ou tempérament, Mme Farrenc se tenait obstinément à l’antipode du sentimentalisme. »
Après la naissance de sa fille Victorine en 1826 Louise Farrenc se retire momentanément des activités publiques pour s’y relancer de plus belle à partir de 1832-33, période où son mari multiplie les éditions de sa femme : plusieurs Rondos brillants op. 9-13, et avec les publications à Londres la compositrice s’affirme comme telle une fois pour toutes. A noter ici son op. 17, son Air russe varié dont même Schumann prend note dans sa revue en 1836 : « Si un jeune compositeur me présentait des variations comme celles de Louise Farrenc, je le féliciterais pour les arrangements judicieux, pour les jolies formations dont elles témoignent partout. »

le thème de cet « Air russe » et à la 7e variation il faut se lancer « con molto fuoco » :

La production de ces années ne se limite pas aux œuvres pour piano. En 1834 la Farrenc propose deux ouvertures op. 23 et 24 dont la deuxième suscite la curiosité d’un large public, surtout après son exécution du 5 avril 1840 à la Société des Concerts du Conservatoire, le podium prestigieux fondé en 1828 pendant la Monarchie de Juillet où s’établit – entre autres – un véritable culte beethovenien, et à côté des symphonies de F. Mendelssohn, de L. Spohr, de F. Ries on affiche aux programmes des symphonie de compositeurs vite oubliés plus tard. La Farrenc y a toutefois droit de cité (grâce à sa 3e symphonie). A l’ombre du géant Beethoven (le « constructeur de cathédrales » selon Vincent d’Indy) composer des symphonies requiert une forte dose de courage et d’assurance, dont dispose Louise Farrenc à l’âge de 37 ans grâce au succès de sa musique de chambre et de son œuvre pianistique. – De facture classique (quatre mouvements, les rapides en forme de sonate) sa 1ère symphonie op. 32 de 1842 peut frapper par la richesse de l’instrumentation. Son exécution d’abord à Bruxelles puis à Paris suscite des commentaires bienveillants comme celui dans la ‘France Musicale ‘ : « Il ne faut pas chercher dans cette composition de ces traits de création vraiment originale comme on en trouve dans les symphonies de Beethoven ; mais qui est-ce qui a cela de nos jours ? Ce que je puis affirmer, c’est qu’après avoir produit un tel ouvrage, Mme Farrenc a conquis le droit d’être placée au rang des compositeurs les plus distingués de l’époque actuelle. » Si Farrenc s’appuie sur Beethoven, Mozart et Haydn, sa symphonie n’est pas pour autant rétrograde. Elle ne fait pas preuve d’innovation comme le romantisme échevelé d’un Hector Berlioz à la même époque, et d’autre part ses symphonies n’aspirent pas aux dimensions « programmatiques » comme ceux de Schubert ou de Schumann que le public français ne connaît d’ailleurs pas.
Le grand succès de sa 3ème symphonie en sol-mineur op. 36 de 1847 est dû à plusieurs traits originaux comme p.ex. les 6 mesures introductives (Adagio)où les bois mettent précautionneusement une suite d’harmonies en route dont l’issue est incertaine, puis le tâtonnement nerveux d’env. 20 mesures de l’Allegro où les bribes d’un thème en perspective avancent par bousculades jusqu’au déclic du thème appelé « idée mère » du 1er mouvement :

La piste est balisée pour avancer jusqu’au thème principal que voici :

Une des caractéristiques retenues par les musicologues est la fréquence des tournants qui destabilisent la charpente harmonique, quand un instrument du registre médian introduit une note qui fait décaler l’avancement harmonique attendu vers d’autres horizons, comme p.ex. au cours du ‘développement’ du 1er mouvement où un sol-bémol de l’alto change la donne, déclenchant ainsi un cheminement quelque peu tordu, parti d’un la-bémol majeur pour aboutir au la-majeur :

Lors de la création de cette symphonie le 22 avril 1849 à la Société des Concerts du Conservatoire elle doit s’affirmer à côté du no. 5 de Beethoven, et le critique déplore cette concurrence déloyale, mais il tient à mettre en lumière les qualités de cet « ouvrage bien pensé, bien écrit » dont « le final (…) couronne dignement l’œuvre de l’estimable compositeur, qui, sans pédanterie scolastique, montre, seule de son sexe dans l’Europe musicale, un véritable savoir uni à la grâce et au goût. »
Malgré le retentissement de sa 3ème symphonie Louise Farrenc va abandonner la composition orchestrale au profit de la musique de chambre et d’autres œuvres pianistiques comme p.ex. la série des études initiée déjà auparavant qui relèvent de son enseignement comme professeure nommée au Conservatoire depuis 1842, une rareté à l’époque. Sa renommée comme pédagogue lui vaut des contacts succulents comme celui avec la cour de Louis-Philippe par le biais de son élève la Duchesse d’Orléans, belle-fille du roi, dans le Salon de laquelle elle se produit avec l’un de ses quintettes ou alors en compagnie de sa fille Victorine, jeune pianiste chevronnée enseignée par sa mère. Parmi les études de niveau gradués écrites à l’intention de ses élèves l’on retient surtout les Trente Études dans tous les tons op. 26 de 1838, un concept déjà réalisé par Muzio Clementi en 1790 avec ses Préludes et exercices dans tous les tons majeurs et mineurs pour le pianoforte ou les Préludes op. 28 de Chopin composé en même temps.
A part quelques numéros criblés de loopings pour la main gauche les 30 études réjouissent l’élève par leur côté chantant où la technique est au service de l’agrément, un peu comme les études de J.B. Cramer publiées env. 30 avant celles de Farrenc. Qu’il nous soit permis de juxtapposer également celles de Chopin op. 10 composées peu avant où la correspondance entre le no. 6 de Chopin et le no. 21 de Farrenc nous révèle le caractère mélodieux que peut avoir une simple étude :


Chopin Farrenc
Le no. 29 développe une triple fugue soupçonnée tirée des Symphonies à trois voix de J.S. Bach – dotée d’un structure contrepointique comparable à celle du maître de Leipzig :

Vers le milieu du siècle la musique de chambre n’est plus confinée dans les milieux bourgeois comme accessoire des activités culturelles à domicile. Les trios, quatuors ou quintettes sont de plus en plus conçus pour les concerts publiques, adressés par conséquent aux professionnels de haut niveau. Ainsi les compositions de Louise Farrenc des années 1840 et 1850 :

Depuis que la Farrenc a été redécouverte vers la fin du 20ème siècle l’on retient surtout son op. 30 : le 1er quintette pour le formation de la Truite de Schubert. Ce Quintette no. 1 en la-mineur – un véritable coup de maître !

L’Allegro initial présente un thème plein de verve à l’unisson, un élan que l’alto reprend aussitôt avec sa courbe vers les aigus passée au violon qui rejoint par une gamme descendante la reprise du thème. Le développement s’annonce par un motif retenu au piano aux croches répétitives qui se mettent au service des cantilènes des cordes. Quant à l’Adagio non troppo le violoncelliste va sans doute se repaître en se lançant dans sa cantilène dans les sphères supérieures de la touche, soutenu délcatement par de minces accords toqués piano :

Quand c’est le tour du violon de chanter la mélodie c’est encore le violoncelle qui l’enguirlande avec des gerbes de doubles croches séducteurs. – Suite à un Scherzo furibond aux modulations à travers tout le jardin l’Allegro final s’annonce vigoureux, propulsé par des arpèges ininterrompus au-dessus la galopade des croches pointées à la main gauche :

Accords brisés, gammes époustouflantes et arpèges à gogo : la pianiste livre son sprint sans trêve pourtant en dialogue par moment avec ses partenaires, le tout marqué par un caractère de propulsion où les notes pointées mènent le débat de part et d’autre, une véritable chevauchée à la hussarde qui peut se prolonge à l’occasion :

Ce 1er quintette est accueilli avec beaucoup de bienveillance et compte aujourd’hui parmi les oeuvres les plus souvent jouées de Louise Farrenc.
Quant à la Sonate pour violoncelle et piano op. 46 en si-bémol majeur, une des dernières œuvres composées avant 1860, la pianiste roule une fois de plus le tapis rouge pour ses ébats du genre Fanny Hensel-Mendelssohn, escortée par le violoncelle comme figurant derrière les virtuosités du clavier. Il suffit de citer n’importe quel passage du mouvement final pour en donner la preuve :

Lorsque notre compositrice rejoint le corps professoral du Conservatoire de Paris en 1842 elle est nommée par le ministre parmi trois candidats proposés par Luigi Cherubini, le directeur jusqu’en 1842. Elle est par ailleurs la seule pianiste à ne pas avoir suivi le parcours traditionnel : élève au Conservatoire – répétiteur – professeur adjoint – professeur nommé. La Gazette musicale retient que « personne n’était plus digne de ce poste important. » Les classes de piano sont récentes, vu que jusqu’en 1772 on enseignait le clavecin. De là la pénurie en matière d’Écoles de piano à part quelques méthodes signées Hummel, Kalkbrenner ou Moscheles. La professeure Farrenc se voit attribuer la classe des jeunes filles. Si d’autres instruments, à part le violon, sont prohibés le piano fait partie de la bonne éducation bourgeoise pour les filles. Antoine Marmontel (professeur de prestige de l’époque) déplore d’autre part le peu de rendement de cet enseignement de futures pianistes professionnelles : « Malheureusement pour l’Art, la plupart des jeunes filles qui se vouent à la virtuosité y renoncent un peu plus tard pour les devoirs austères de la famille. »


réalité – et portrait idéalisé (sur la pochette d’un CD) de Louise Farrenc
Aussi honorifique que soit sa nomination Louise Farrenc n’est pas à l’abri de quelques contrariétés comme p.ex. la rémunération inférieure à celle des collèges masculins, ou alors les mères récalcitrantes à l’idée de confier leur fille à une femme-professeur. Néanmoins, parmi ses élèves il y a bon nombre de futures virtuoses, en premier lieu sa fille Victorine avec qui elle se produit publiquement au piano à quatre mains et qu’elle a la douleur de perdre en 1859. Comme pédagogue elle se distingue entre autres par ses séries d’études à l’intention de différents niveaux.
Sur le plan de la recherche Louise s’allie à son mari Aristide Farrenc qui ne craint point les écueils sur la voie de l’historien vers les sources originales. Les sonates de Beethoven lui semblent mal documentées en France il se lance dans la première édition intégrale française. Quant à la musique ancienne elle est pratiquement inconnue ici au début du siècle, mis à part le Clavecin bien tempéré de J.S. Bach édité en 1801. Vers les années 1830-1840 on dépiste dans les programmes quelques rares apparitions de Gluck, de Rameau, De Haendel ou de Pergolèse. Et c’est le mérite de François-Joseph Fétis, professeur de composition au Conservatoire de Paris et directeur de celui de Bruxelles depuis 1830 d’avoir déterré pour le monde musical en France les trésors de la musique baroque dans son ouvrage de référence Biographie universelle des musiciens de 1834 et d’avoir organisé ses ‘concerts historiques’ consacrés aux 16e et 17e siècle. Notre compositrice, familiarisée avec les travaux de son mari, est séduite par les recherches de Fétis et va sortir sous peu son propre ouvrage intitulé Le Trésor des pianistes, faisant la promotion d’œuvres baroques dans son propre récital de 1857 et dont le critique de la ‘Gazette musicale’ ne semble pas emballé outre mesure : « Une séance de musique rétrospective, dite historique, a été donnée aussi par Mme Farrenc un de ces jours passés, musique de piano bien entendu. Frescobaldi, Chambonnière, Corelli, Couperin, les Bach, Porpora, Scarlatti etc., ont fait les frais de cette exhumation classique qui peut avoir son mérite, mais mérite un peu monotone et un peu ennuyeux – il faut avoir le courage de la dire – avec ses gruppetti, ses mordants, son style continuellement serré l’imitations… ». Ce sont précisément ces multiples agréments ou appoggiatures baroques auxquels la pianiste consacre le chapitre Traité des abréviations de son livre cité ci-haut : « Ces ornements sont en grande partie abandonnés aujourd’hui, à cause de la différence du volume de son qui existe entre nos pianos et le clavecin ; mais leur connaissance n’est pas moins indispensable pour l’exécution des œuvres appartenant au dix-septième et dix-huitième siècle : si on les négligeait, la musique des vieux maîtres serait dénaturée ; elle perdrait sa véritable physionomie et son effet. » – Inutile de souligner que la professeure fait découvrir la musique baroque à ses élèves au Conservatoire où elle enseigne jusqu’en 1873 (âgée de 69 ans).
Les contributions de Louise Farrenc à la culture musicale de l’époque n’a pas échappé aux critiques contemporains. Tel cet hommage de Fétis dans la ‘Gazette musicale’ du 19 mars 1865 : « Artiste d’un mérite éminent, et douée d’une organisation musicale toute masculine, Mme Farrenc a conquis la plus haute estime des connaisseurs par de grandes compositions où se manifeste une force de tête qui ne semble pas appartenir à son sexe. » Ou alors Marmontel en 1851 dans son ouvrage ‘Les pianistes célèbres ‘ : « …femme à la stature élevée, à l’aspect presque viril, aux cheveux argentés moins encore par l’âge que par la fièvre de la pensée. »
Toujours est-il que l’admiration des contemporains pour notre musicienne n’est pas exempte de stupéfaction à l’égard de l’artiste en tant que femme, un peu comme la légère surprise du passager moyen de nos jours installé dans la cabine d’un Jumbo-Jet qui entend une voix féminine venant du Cockpit…
S O U R C E S :
Catherine Legras, Louise Farrenc, compositrice du 19e siècle, L’Harmattan, Paris 2003
Christin Heitmann, Die Orchester- und Kammermusik von Louise Farrenc, F. Noetzel-Verlag, Wilhelmshaven 2004
Rebecca Grotjahn et Christin Heitmann (éd.), Luise Farrenc und die Klassik-Rezeption in Frankreich, BIS-Verlag, Universität Oldenburg 2006
E N R E G I S T R M E N T S :
Parmi les nombreux youtubes (audio ou film) des œuvres orchestrales notons le coffrets des CDs par Maria Stratigou : Louise Farrenc – complete piano works (NAXOS) ou les vidéos d’œuvres pour piano par Julien Lambert. A signaler aussi le très beau youtube-film du Quintette en la-mineur no. 1 par le Franz Ensemble (document de la télévision ARD).
-
Georges Bizet: son Prix de Rome – son aventure italienne

Bizet à 19 ans (© Lifermann/Musées de la Villa de Paris) Depuis 1803 le Prix de Rome est décerné aussi aux jeunes compositeurs du Conservatoire de Paris, à une époque où la musique italienne des siècles précédents jouit d’une grande popularité. Autour de 1850 cependant la production musicale italienne semble se trouver sur son déclin, mais le lauréats du Prix se lancent à la découverte de la culture de l’antiquité et de la renaissance du pays. – En 1857, peu avant Noël, Georges Bizet (19 ans, Prix de Rome pour sa cantate ‘Clovis et Clotilde’) et deux de ses amis mettent le cap sur le sud, mais Bizet est le seul à avoir pris des cours d’italien à Paris. L’itinéraire des trois lauréats: la Provence – la Côte d’Azur – Gênes – Livourne – Pisa – Lucca -Florence – Rome. Arrivé à Gênes Bizet est exaspéré par l’omniprésence des mendiants et il manifeste sa déception, voire son mépris pour la population : « Dans toutes les petites villes, les femmes sont bigotes et d’une vertu farouche, excepté pour leurs confesseurs. Du reste, les hommes sont aussi cagots que leurs femmes et dans ce diable de pays on ne pense qu’à mendier » (dans une des lettres à sa mère). S’il va s’enthousiasmer ensuite pour le patrimoine de la Renaissance florentine, ce « paradis féérique », le pays lui semble à prime abord débordé d’une « architecture horrible, d’église peintes comme des monuments de carton… ». Même la ‘découverte’ de Rome lui réserve un arrière-goût déplaisant : « Il y a beaucoup à admirer, mais il y a bien des désenchantements. Le mauvais goût empoisonne l’Italie. C’est un pays complètement perdu pour l’art » (à sa mère). A ce propos Bizet suit la route déjà balisée par Gounod, Prix de Rome de 1839 :

Charles Gounod en 1840 à Rome – par Erbest Hébert, pentre boursier à la Villa Medici (© Liturgia) 
Rome au 19e siècle
« Je me trouvais dans une vraie ville de province, vulgaire, incolore, sale presque partout ; j’étais en pleine désillusion… » et par Berlioz en 1831, d’ailleurs contre son gré en Italie : « J’arrivais de Paris, du centre de la civilisation, et …. Je me trouvais tout d’un coup sevré de musique, de théâtre, de littérature, d’agitations, enfin de tout ce qui composait ma vie… ». Berlioz n’est pas le premier à souligner la supériorité de l’art français à celui de l’Italie de son temps. Même Stendhal, le grand explorateur de l’Italie, retient dans son journal de 1817 que « des gens d’esprit me soutiennent que tel barbouilleur au-dessous des nôtres est excellent, uniquement parce qu’il est de Rome. » Et Bizet, arrivé à Rome en 1858, lance cette boutade à propos de l’ignorance ambiante: « Il suffit de faire la gamme de do-majeur avec les deux mains pour être considéré comme un grand artiste. »Installé en janvier à l’Institut français de la Villa Médici Bizet s’introduit rapidement dans la bonne société romaine, se fait un nom comme pianiste et compte parmi les habitués de l’ambassade russe. Mais sa facilité de nouer des contacts ne l’empêche pas de se lancer dans le travail, voire dans un Te Deum, probablement celui de ses prédécesseurs Charpentier ou Berlioz à l’oreille – et dont ouverture ressemble davantage à la ‘Marche triomphale’ dans Aïda de 1871 qu’à une cérémonie religieuse : Les coups assénés de ces accords syncopés du la-majeur/fa-dièse-mineur qui propulsent le fortissimo du chœur, suivis par les nombreuses croches pointées figurent une espèce de marche militaire :
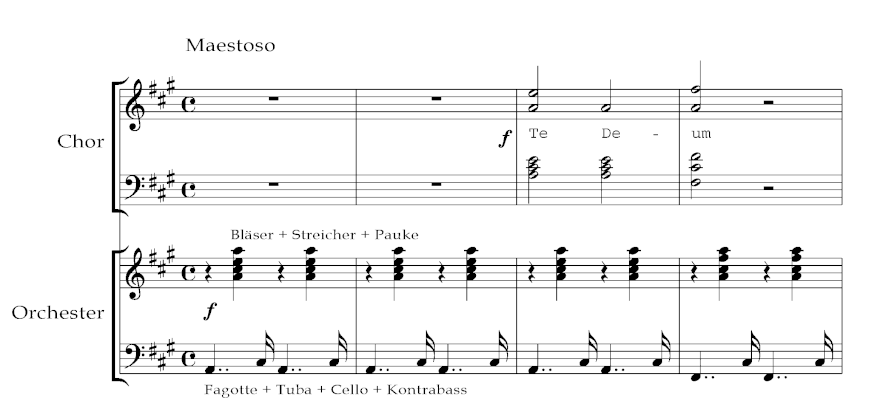
Ce caractère pompeux trouve son équivalent dans la partie des solistes sur « Tu Rex gloriae… », aboutissant dans une escalade chromatique du ténor ‘héroïque’ digne d’un Otello vers son fa-majeur lumineux au-dessus des rythmes pointés (« Tu ad dexteram Dei sedes… ») :

Mais il n’y a pas que du pathétique : La prière « Miserere nostri, Domine » surgit des profondeurs, à peine audible, articulée par les basses du chœur et soutenue délicatement par le ré-majeur des cordes, le tout s’évanouissant dans un pianissimo.
Ce Te Deum qui devrait remporter le « Prix Rodrigues » ne s’est jamais imposé. Après avoir sombré dans les archives pendant plus de 100 ans la Singakademie de Berlin va le créer le 16 mai 1971.
Dans la lettre du 17 avril 1858 à sa mère Bizet confesse son mal à finir son Te Deum : « Je ne sais qu’en penser. Tantôt je le trouve bon, tantôt je le trouve détestable. Ce qu’il y a de certain, c’est que je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse. » – Mais en dehors de ces embarras les 2 années à Rome passent pour la période la plus heureuse de sa vie. Si d’une part il a peu d’estime pour la population qui, de son côté, se méfie de ces jeunes Français orgueuilleux, venus d’un pays aux ambitions impériales de Napoléon III. Les pensionnaires de la Villa Medici vivent dans leur cocon sans se mêler à la vie publique italienne. Par contre les trésors de l’antiquité et le paysage bucolique autour de Rome ont envoûté notre jeune musicien dès son arrivée, ce paysage de la fameuse « Italien-Sehnsucht » exprimée par Goethe dans son « Voyage en Italie ». De plus, la curiosité littéraire de Bizet ne connaît pas de limites : le pensionnaire s’approvisionne dans la bibliothèque de l’Institut largement fournie, dévorant les textes de l’Antiquité (d’où une ébauche d’opéra sur ‘Ulysse et Circé’), les Italiens comme Manzoni, Goldoni ou Foscolo, l’Espagnol Cervantes – et avant tout la littérature dramatique : Shakespeare presqu’en entier, Schiller et Goethe, Beaumarchais. Rien d’étonnant à ce qu’il se sente attiré par l’idée d’écrire des opéras dont quelques ébauches seront laissées en plan. Quant à Stendhal : aurait-il lu les « Voyages en Italie » ou les « Chroniques italiennes » ? Ses lettres de Rome n’en parlent pas.
la Villa Medici à Rome En 1859 Bizet part avec 2 amis pour un voyage à travers le pays dont il livre méticuleusement les détails dans ses lettres. Une première étape les conduit à Naples et à Pompéi dont il laisse ce commentaire saugrenu : « Ici, à Pompéi, on ne voit que des morts, et je serais bien aise de savoir ce que font les vivants. »

Pompéi en 1850 par F. Federer
Ce séjour à Pompéi pique pourtant sa curiosité, tandis qu’il est déçu par Naples, où habite Mercadante, le compositeur qu’il devrait contacter moyennant une lettre de recommandation de son professeur Carafa de Paris. La visite n’aura pas lieu, une attaque d’angine l’oblige à retourner à Rome.
Vers la fin de l’année Bizet demande à l’Académie de Paris de pouvoir prolonger son séjour, une pétition soutenue par le directeur de la Villa Medici, le peintre Victor Schnetz. – A la recherche d’un sujet d’opéra il va dénicher chez un antiquaire de Trastevere un livre qui l’intrigue : Don Procopio , un texte dont Bizet se propose de faire un vrai opéra italien : « Sur des paroles italiennes il faut écrire une musique italienne. » En même temps il s’attaque à un autre projet, intitulé Esmeralda, sur le roman ‘Notre-Dame de Paris’ de Victor Hugo. Tiraillé entre la musique sacrée et l’opéra, il s’attire des remontrances de la part d’Ambroise Thomas de Paris à propos de ses œuvres bouffonnes : Un vrai compositeur qui veut montrer ses qualités est censé d’écrire d’abord des œuvres sacrées ! – Bizet s’y accommode malgré lui, disant qu’il ne se sent pas en « état chrétien », que sa religion est « païenne » et que le texte d’Horace sur Carmen saeculare le tente davantage qu’une messe : « J’ai toujours lu avec un immense plaisir les auteurs de l’Antiquité, tandis que chez les chrétiens je n’ai trouvé que méthodologie, égoïsme, intolérance et absence totale de goût artistique. » Et il ne manque pas d’aplomb quand il dit à sa mère : « Tu me demandes des nouvelles de mon envoi. Voici : Je n’enverrai que Vasco. (…) Puis le style que j’emploie dans mon ‘Carmen seculare’ serait de l’hébreu pour MM. Clapisson, Carafa et autres semblables. (…) Je suis très content de ce que je fais du ‘Carmen secualre’, mais c’est pour moi…et pour vous. »
Contrairement au succès fulminant de sa ‘Carmen’ d’env. 20 ans plus tard, sa Carmen seculare n’aboutira pas, et à la place d’une messe requise il envoie à l’Académie les feuillets d’un opéra intitulé Vasco de Gama basé sur un texte portugais de la Renaissance, mais le jury de Paris le taxera inférieur aux œuvres de Thomas, de Verdi ou de Halévy. Bizet estime de son côté que le Verdi actuel ne rejoint plus le niveau de ses œuvres de jeunesse comme Il Trovatore, La Traviata ou Rigoletto. Il va jusqu’à prétendre que le goût des Italiens pour l’art a dégringolé, que personne ne connaît ici Rossini, Mozart, Weber, Cimarosa. A Gounod il confesse dans une lettre que depuis 9 mois il n’a plus entendu une seule note de bonne musique et que dès lors il se sent incapable de juger ses propres compositions. Gounod reste pour Bizet le plus grand compositeur contemporain. Son Faust lui semble le chef-d’œuvre qui dépasse son genre – et l’insuccès des représentations dû à la médiocrité des acteurs le met en colère. Quant à Wagner il confie à sa mère que dans ses partitions « il n’y a absolument rien », que « ce sont des œuvres d’un homme qui, manquant d’inspiration mélodique et harmonique, s’est livré à l’excentricité… », jugement qu’il va réviser après avoir assisté au Tannhäuser en 1861 à Paris !
En juillet 1860 Bizet quitte Rome, en compagnie de son ami et co-pensionnaire J.B.L. Guiraud de la Villa Medici. Tandis que Guiraud aime faire la grasse matinée, Bizet se lève de bonne heure, impatient de découvrir le monde inconnu. On passe par Pérouse, Assise, Pesaro (Rossini), Ravenne et Padoue pour arriver à Venise. Dans ses lettres à sa mère il la fait participer à ses découvertes, sans la moindre allusion bien sûr à ses autres aventures dans les tavernes et les bordels. Pendant tout ce voyage il rumine le projet d’une symphonie ‘italienne’ dont le titre définitif sera Roma , après avoir pensé à une suite aux 4 mouvements intitulés « Rome-Venise-Florence-Naples ». Après de nombreux remaniements – encore bien après son retour à Paris – la version définitive s’ouvre sur un hymne aux quatre cors qui associe moins le paysage du Latium qu’un décor alpin évoqué plus tard par Brahms, Strauss et Lauber :
Selon le biographe W. Dean ce 1er mouvement intitulé Une chasse dans la forêt d’Ostie doit son essence au Freischütz de Weber (le compositeur que Bizet tient en grand estime) et à Gounod, d’aucuns y ont flairé du Wagner…

Quant au contexte d’une chasse déjà préfigurée par les cors, la seconde partie Allegro agitato nous emmène dans une cavalcade le long d’un thème annoncé préalablement par la trombone et développé ici dans les cordes accompagnés d’une galopade saccadée dans les vents.
Le Scherzo (Allegretto vivace), une fugue à trois temps dont le thème s’étend sur 14 mesures, se rapproche par son allure pétillante de l’habitus de la Symphonie italienne de Mendelssohn. C’est le mouvemenet le mieux apprécié par les critiques :
thème du Scherzo Le thème doucereux de l’Andante molto pourrait suggérer les émotions vécues dans un paysage bucolique : la mélodie s’écoule à pas feutrés dans les cordes et plus loin dans les bois, flanquée par les arabesques du 1er violon – et son écho dans l’Adagietto de la 1ère Suite Arlésienne (1872) saute aux yeux :

Quant à rapprocher le mouvement final (Allegro vivacissimo) intitulé Carnaval de Rome du ‘Carnaval romain’ de Berlioz, cela peut s’avérer fantaisiste, à moins que ce soient les triolets galopants et les rythmes pointés qui rappelleraient l’Allégro vivace endiablé du 6/8 de Berlioz. Toujours est-il que dans cette tarentelle Bizet fait preuve d’une vraie maîtrise : à voir l’agencement des thèmes dans les cordes, leur reprise dans les bois, les sonorités aériennes des triolets dans les aigus ou dans les arpèges de la harpe, la dynamique de la propulsion par les croches pointées suivies de guirlandes des doubles croches dans les cordes – et le déluge de gammes à l’unisson vers l’apogée du do-majeur final.
Georges Bizet débarqué à Venise rejoint Paris à l’improviste, suite à une lettre qui lui annonce une aggravation de la santé fragile de sa mère.La communauté des « Carménophiles » fascinés par le feu andalous dans l’opéra à succès de Bizet de 1874 ne trouveront que peu d’italianismes dans les compositions réalisées en Italie entre 1858 et 1860.
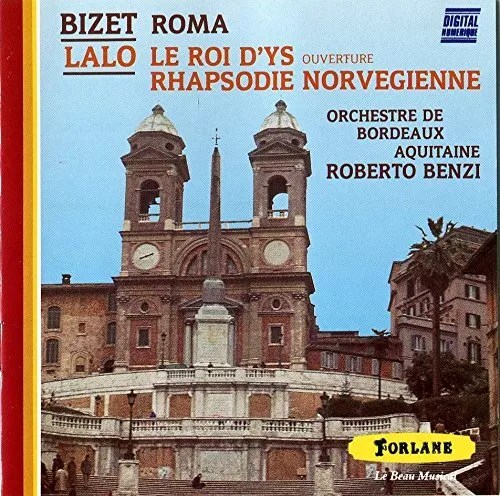
La suite symphonique de Roma restera dans l’ombre de sa Symphonie en ut de 1855, jusqu’à ce que Gustav Mahler la reprenne en 1901 à Vienne, et selon le redoutable critique Hanslick cette œuvre contiendrait sans doute des éléments ingénieux et ferait preuve d’une instrumentation charmante, mais que l’ensemble serait toutefois teinté d’une atmosphère d’opéra…S O U R C E S :
Georges Bizet, Lettres – impressions de Rome, éd. Calmann-Lévy, Paris 1908
Christoph Schwandt, Georges Bizet – eine Biographie, Schott Music GmbH, Mainz 2011
Rémy Stricker, Georges Bizet, éd. Gallimard, Paris 1999
Winton Dean, Bizet, Dent and Sons, Londres 1948/1965
Stendhal, Voyages en Italie, éd. Gallimard (Pléiade) Paris 1973E N R E G I S T R E M E N T S :
Te Deum et Roma: plusieurs youtubes à choix (audio et film), en partie avec partition synchronisée
-
Darius Milhaud – compositeur juif et cosmopolite

Darius Milhaud en 1923 (dom. public)
Né en 1892 dans une famille juive dont les racines remontent à l’époque des juifs du Comtat Venaissin centrés sur Carpentras et Cavaillon au Moyen Âge tardif, une région où se développe un judaïsme à part, ni sépharade (comme celui de la Côte d’Azur) ni ashkénaze (comme au nord de la France). Ces juifs parlent le dialecte judéo-provençal (une sorte d’occitan hébraïsé) et ils jouissent de la protection des papes en résidence à Avignon au 14e siècle. Son arrière-grand-père Joseph Milhaud était l’auteur d’ouvrages d’exégèse de la Torah et devait recenser les israélites lors de l’intégration du Comtat Venaissin à la nation française après la Révolution. Le petit Darius vit une enfance heureuse à Aix-en-Provence, entouré d’une parenté nombreuse, fasciné par l’humour de ses cousines et les manières ‘parisiennes’ de son oncle Michel. Les séjours estivaux de la famille dans la propriété de l’ »Enclos » dans les collines environnantes comptent parmi les moments les plus lumineux de cette période (telles les vacances des Pagnol à la »Bastide Neuve » de la campagne marseillaise à la même époque – voir Marcel Pagnol, Le Château de ma mère). Comme la musique fait partie de la culture familiale on confie Darius dès l’âge de 7 ans à Léo Bruguier, professeur de violon. Ses progrès sont tels qu’il fait partie du quatuor de son maître 5 ans plus tard. On joue le répertoire classique, mais c’est surtout Debussy qui lui révèle les dimensions d’une musique toute nouvelle, à quoi vont s’ajouter la découverte de Ravel, d’Ernest Bloch, des opéras et des ballets russes, du novateur Stravinsky lors de ses années au Conservatoire de Paris depuis 1909 où la composition l’emporte sous peu sur le violon, comme il dit dans son autobiographie : « A mesure que ma nature musicale s’épanouissait, l’étude du violon me paraissait plus fastidieuse, il me semblait que je volais du temps à la composition… », ce qui « trouble » bien sûr sa mère !
Darius Milhaud confesse son appartenance à la religion israélite, dans pour autant revendiquer l’étiquette de « compositeur juif ». Il devra sa répercussion dans le monde musical plutôt à ses œuvres pénétrées de rythmes brésiliens (Saudades do Brazil 1920 – Scaramouche 1937) et d’éléments du jazz (La Création du monde 1923). Pourtant, ses compositions d’inspirations juives, en partie des miniatures, comptent une vingtaine de titres, en majorité des œuvres vocales, et s’échelonne sur toute sa vie.
Paris lui permet de connaître les poètes comme Paul Claudel ou Francis Jammes, d’où ses premières compositions, les cycles de « Poèmes » entre 1910 et 1916. – Les Poèmes Juifs op. 34 de 1916 (traduits de l’hébreu) semblent inaugurer la série de ses œuvres d’inspiration juive. Il les appelle dans une lettre « ces poèmes de mon pays. » Son ami Charles Koechlin lui adresse ce commentaire : « Vos mélodies juives me plaisent et m’émeuvent beaucoup. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est l’union de la mélodie et de la partie de piano. » Il y est question de la bitonalité. Le Chant de la pitié qui parle d’une vieille tombe « dans les champs de Bethléem » nous en livre un spécimen particulier où la ligne du do-majeur de la voix et d’une figure à la Mozart dans la main droite du piano s’appuie sur les quintes superposées du do-dièse/sol-dièse/ré-dièse en dissonance avec le reste :
une pierre se dresse solitaire… Les Chants populaires hébraïques de 1926 évoquent les soucis quotidiens du petit peuple, l’isolation du veilleur de nuit, le chagrin d’amour, la pauvreté, des mystères du Talmud (Chant hassidique) et contiennent, comme tous les albums yiddishs, une berceuse : « Dors, dors, dors, ton papa ira au village et te rapportera une soupe… » La voix déambule en général à l’intérieur d’un mode mineur ou majeur, tandis que l’accompagnement lui soumet des accords ouvertement dissonants, tout en y introduisant à l’occasion des changements de mesure, des éléments que son ami Francis Poulenc (du Groupe des Six) a déjà introduit dans son Bestiaire de 1916 sur des textes d’Apollinaire.
Afin de faire référence au judaïsme local de Carpentras (avec la plus ancienne synagogue de France) Milhaud se propose de créer un opéra sur le figure biblique d’Esther, intégrée ici dans le contexte des jours de Pourim. Esther de Carpentras de 1925-27, cet opéra-bouffe d’après un livret du poète Armand Lunel, son ami d’enfance de la même année et du même milieu juif, rappelle la reine Esther de l’exil babylonien qui a imploré le roi Ahashver (Xerxes) de contrarier le plan du génocide des juifs revendiqué par un haut magistrat du royaume. Livré au charme de la belle le roi a renversé la donne et permis aux juifs par un décret de tuer leurs ennemis à une certaine date de l’année, suite à quoi les Hébreux ont passé à l’acte en exprimant leur triomphe par la fête du Pourim, le carnaval juif.
La synagogue de Carpentras
Dans l’opéra de Milhaud les juifs de Carpentras se voient menacés de la conversion imposée ou de l’expulsion par le Cardinal-évêque du Comtat Venaissin (selon le « modèle » espagnol de 1492). Mais la belle Esther réussit à le convaincre de reconsidérer son verdict, si bien que les juifs pourront continuer à pratiquer leur foi.
A l’encontre des commentaires souvent acerbes de la part de certains critiques fidèles à l’antisémitisme ambiant de l’époque André Coeuroy ne va pas réitérer que les œuvres juives ne sont que cacaphonie et bizarreries exotiques et ne parle pas de « concerts métèques ». Sa chronique de 1938 sur la représentation parisienne de notre opéra est teintée d’une bienveillance inattendue : « A la générale d’Esther de Carpentras, ils y étaient tous…(le compositeur, le librettiste, des écrivains connus etc.) C’était une fort belle chambrée qui fît un succès, d’ailleurs bien mérité, à cette Esther. On nous la présentait comme un épisode à la fois historique, social et religieux de la vie juive dans le Comtat-Venaissin au 18e siècle… » et de souligner la qualité lyrique de cette œuvre burlesque !
Comme la plupart des artistes juifs Darius Milhaud quitte la France avec sa femme Madeleine en 1940 pour s’installer en Californie. Le Mills College à Oakland lui offre un poste de professeur de composition que Milhaud occupera jusqu’en 1947.
pochette du disque 
Milhaud comme professeur avec ses étudiants A part les œuvres mineures de thématique juive (Prière journalières, Liturgie comtadine, Cantate nuptiale, Caïn et Abel, Kaddish) son SERVICE SACRÉ de 1947 jouit d’une répercussion bien au-delà du contexte provençal. Suite au Service Sacré d’Ernest Bloch des années 1930 et à celui de Mario Castelnuovo-Tedesco de 1943 (le compositeur juif également émigré aux Etats-Unis) l’œuvre de Milhaud commandée pour la synagogue de San Francisco va être créée en 1947 avec le compositeur à la baguette, une œuvre définie comme « richement romantique » par l’un des critiques. Son caractère « sacré » se manifeste par la fréquence des sonorités solennelles dans le cordes graves qui soutiennent le discours du chantre, par le rôle de l’orgue ou par les séquences jubilatoires du chœur sur les paroles de louange. Ainsi p.ex. dans la 1ère partie le Tzur Ysrael (« Rocher d’Israël, lève-toi pour aider Israël… ») où, selon les traditions ancestrales les mélismes aléatoires du chantre, qui est censé de toucher le cœur des fidèles, reposent ici sur une ligne ondoyante des contrebasses. La mélopée de la prière peut suivre certains schémas mélodiques appelés nouçah ou nigoun, tout en laissant une marge de manœuvre à l’improvisation. – Dans le Va’anahnu de la 4e partie (Psaume 114) le dialogue entre le chantre et le chœur ouvre un hymne sur « et nous louerons le Seigneur dès maintenant… », dialogue proche de celui du même numéro dans le Service sacré de Castelnuovo-Tedesco entre les voix des femmes et des hommes. – Quant aux harmonies Milhaud sait juxtaposer les accords majeurs de conclusion aux passages de bitonalité, un élément propre à l’ensemble de ses compositions.
Autour de 1950 Darius Milhaud navigue entre les deux Amériques et la France, il enseigne en Californie à côté de Schönberg, écrit sur commande des œuvres pour la scène et finit la série des quatuors avec le no. 18. De séjour à Paris il compose en décembre 1951 un cycle de sept pièces pour piano appelées Le Candélabre à Sept Branches (op. 315), une ‘Ménorah’ musicale consacrée aux fêtes du calendrier hébraïque et créée en Israël en 1952 par Frank Pelleg.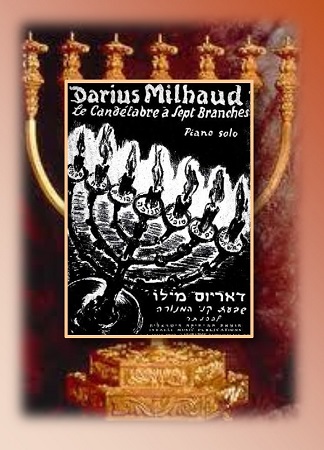
La page introductive Roch Hachana (Nouvel-An) présente une partition aérée souvent à deux voix rappelant les Inventions de J.S. Bach, tandis que Yom Kippour (Pénitence et Pardon) frappe par ses accords pesants en profondeur posés contre ceux descendant de l’aigu (le poids des péchés ?), avant qu’apparaissent au milieu des figures filigranes glissant vers des sonorités en majeur (le pardon divin ?).
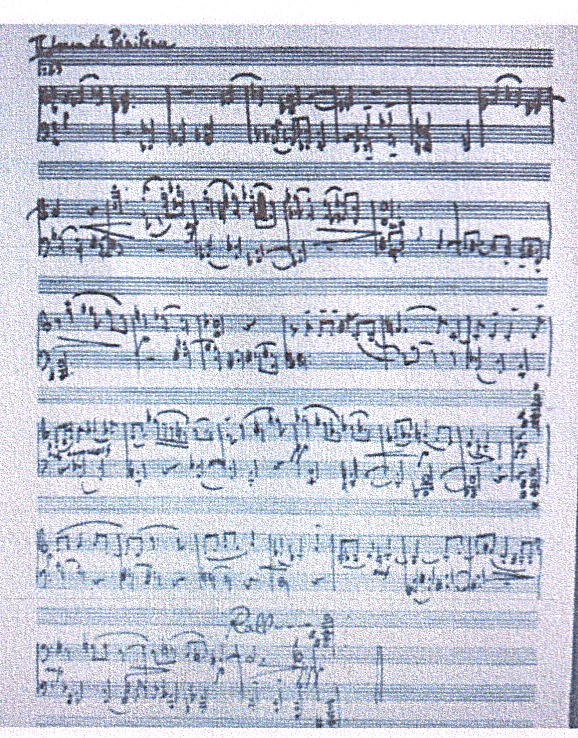
page manuscrite de Yom Kippour
Le Souccot, une danse éruptive fortement rythmée, est suivi par une page consacrée à la Résistance des Macchabées, une escalade d’accords qui convergent entre graves et aigus, débouchant sur une fanfare triomphante, et la partie de la Reine Esther surprend par la légèreté du discours le long d’une oscillation entre le ternaire et le binaire.
Bien que de matière juive ce cycle pianistique n’a nullement recours au patrimoine musical juif, ni même dans les œuvres de type sacré. Milhaud se définit lui-même comme compositeur inscrit dans la tradition française.DAVID

‘David’ exécuté à Los Angeles en 1956
En juin 1954 l’état d’Israël met sur pied des festivités pour commémorer la fondation de la ville de Jérusalem il y a 3000 ans. Milhaud est sollicité de composer un opéra sur le roi David. C’est un projet d’envergure pour solistes, orchestre et deux chœurs. Quant au texte il peut se fier à son ami Armand Lunel qui écrit un livret en hébreu basé sur les Livres Samuel de l’Ancien Testament. Afin de se familiariser avec la matière Les deux amis se rendent en Israël, invités par le gouvernement Ben Gurion. Milhaud est bouleversé face aux lieux historiques et impressionné par cette jeune nation capable de s’affranchir contre les forces ennemies : « La description de leur lutte opiniâtre et magnifique créait un tel lien entre leur héroïsme et celui de leurs ancêtres que cela nous donna l’idée d’utiliser cette similitude dans notre opéra, en mettant deux chœurs en présence : l’un pour la nécessité de l’action, l’autre formé d’Israélien modernes (…) comme David affrontant seul Goliath, ils avaient résisté seuls à la puissance de cinq nations. » – Les 5 actes suivent le destin de David : l’onction du roi et Goliath – la couronne – la forteresse de Sion devient Jérusalem – l’arche de l’alliance, Bethsabée et les fils Salomon et Absalom – le vieux David et Salomon le successeur. Comparé au Roi David d’Arthur Honegger de 1924 dont Milhaud dit que « les auditions se succédèrent rapidement à Paris au cours desquelles plusieurs morceaux (…) étaient régulièrement bissés ». Son amitié pour Honegger s’aligne d’ailleurs à celle de Francis Poulenc : les deux amis du Groupe des Six viennent accompagner les derniers jours de Honegger à Paris en 1955.

le Groupe des Six avec Jean Cocteau au piano, D. Milhaud à gauche et A.Honegger troisième de gauche 
couverture de la partition par Marc Chagall
Le David de Milhaud est un opéra « durchkomponiert » selon la formule de Wagner : Les parties des chœurs et les solistes avec leurs chants parlants (les valeurs des notes et le rythme suivent de près le rythme des paroles) s’enchevêtrent, et l’orchestre fortement doté de cuivres souligne le caractère dramatique par une polyphonie de densité symphonique, pleine d’accord atonales, de bitonalité et chargée d’expressivité dans les contrastes : L’apparition du jeune berger s’accompagne d’une ligne diatonique et d’un chorale, sa prière d’une harpe et d’une sonorité douceureuse, tandisque l’entrée sur scène de Goliath qui crie « Tremblez, petits Hébreux, tremblez ! » est flanquée d’explosions d’accords tonitruants et de secousses dans les basses. Le roi Saül que David a si souvent consolé avec son chant à la harpe (ici comme une berceuse d’un 6/8) est blessé à mort dans la bataille contre le Philistins et implore l’Amalécite (un de ses soldats) de lui donner le coup de grâce. Ce dernier vient rapporter les faits devant David qui se déchaîne contre ce messager et revendique sa mort, un passage hautement dramatique aux trilles stridentes accompagnées d’une dégringolade d’accords de septième majeurs vers le coup du fortissimo dans les graves :
Cet éclat de fureur est suivi illico par la complainte funèbre de David et suivi par une déclamation homophone du chœur. – David couronné roi la cour (acte III) mène le débat sur la capitale à choisir. Ce ne sera pas Hébron, mais Jérusalem sur la montagne sainte de Sion. Le sublime du moment est ressorti par l’absence de l’orchestre et la déclamation linéaire du roi (suivi par le choral du chœur des Juifs) sur le choix irrévocable de Jérusalem :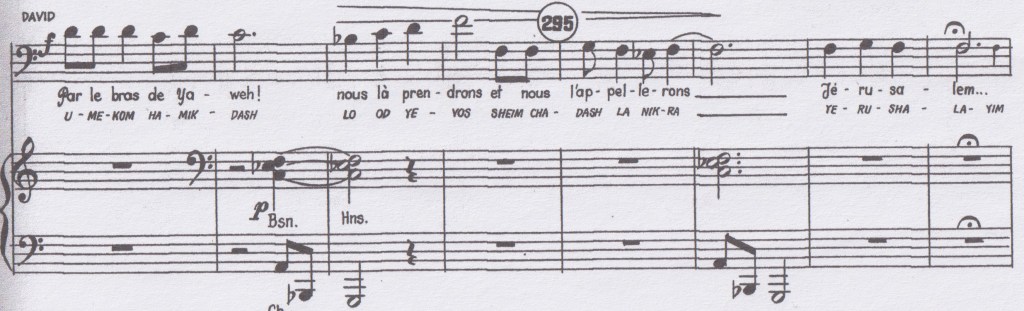
Cette longue partie du choral culmine dans l’ accord final d’un fortissimo en fa-majeur pur sur les paroles « Jérusalem…pour l’Éternité ! »
Le quatrième acte évoque l’épisode de Bethsabée et se distingue musicalement par la tendresse, surtout autour de la mort de l’enfant que Bethsabée avait conçu de David. Après qu’elle a soufflé au pianissimo son « L’enfant est mort » aux sons filigrane des solos des cordes dans les aigus, David articule son repentir : « un jour c’est moi qui m’en irai vers lui » (l’enfant mort), un chant lugubre porté par les tierces dans les bois descendant doucement la pente et une vague discrète montant des profondeurs par la contrebasse :
Milhaud ajoute en exergue de la partition :
Après quelques œuvres de source religieuse comme la Cantate de l’initiation (Bar Mitzvah Israël) op. 388 de 1960, la Cantate ‘From Job’ op. 413 de 1965 et une Ode pour Jérusalem op. 440 de 1972 Darius Milhaud nous laisse avec le chant Ani Maamin op. 441 de 1972 sa toute dernière œuvre, une confession de foi issue d’un texte de Maïmonide et intégrée, comme version populaire, dans le canon des prières et mise en musique par un hassid nommé Azriel David Fastag déporté à Treblinka, un chant souvent repris par les juifs en détresse (p. ex. dans les camps). Une autre version, plutôt joyeuse, exprime l’espoir de l’arrivée du Messie : Ainsi le 12ème des 13 versets : « Je crois avec une foi totale en la venue de Machia’h, et bien qu’il puisse tarde, néanmoins, j’attends chaque jour qu’il revienne. » Milhaud s’appuie sur le poème Ani Maamin (« Je crois ») d’Elie Wiesel, rescapé d’Auschwitz, dans lequel il est question d’un Pessah sans ressources au milieu de l’horreur du camp, célébré par les détenus démunis, où s’entrecroisent le désespoir (« la parabole de Chad Gadya est trompeuse : / Dieu ne viendra pas / Pour tuer le massacreur ») et l’espoir malgré tout (« Je t’attandrai. / Et même si tu me déçois / Je continuerai à attendre, / Ani Maamin »).

pochette du disque 
Elie Wiesel Elie Wiesel (Dans le livre La Nuit Elie Wiesel rappelle la scène de la pendaison d’un petit garçon, où son co-détenu dans le rang se demande où est Dieu dans tout cela, et Elie de lui répondre : Là-bas, au poteau !). Milhaud fait de ce poème une cantate pour soprano, 4 récitants, chœur et ensemble instrumental, créé au Festival d’Israël en 1973. A côté des longs passages réservés aux récitants, le chœur exprime la détresse en persistant dans un fortissimo d’accords dissonants dans les aigus.

Darius Milhaud au pupitre (peintre inconnu)
En juin 1972 Milhaud achève son autobiographie avec la sérénité qui lui était toujours propre : « J’ai eu une vie heureuse, et si Dieu le permet, j’espère continuer à travailler et à jouir de la présence de ma femme et de mes enfants pendant quelques années encore… »
la tombe familiale 
Paris
Le 22 juin 1974 son cœur arrêtera de battre. Darius Milhaud est inhumé au Cimetière Saint-Pierre d’Aix-en-Provence, pas loin de la tombe de Paul Cézanne.S O U R C E S :
Darius Milhaud, Ma vie heureuse, éd. Belfond, Paris 1973
Micheline Ricavy, Darius Milhaud : un compositeur français humaniste, éd. Van de Velde, Paris 2013
Jacinthe Harbec et Marie-Noëlle Lavoie, Darius Milhaud, compositeur et expérimentateur, (MusicologieS), éd. Vrin, Paris 2014
Jennifer Walker, Darius Milhaud, ‘Esther de Carpentras’, and the french interwar identity crises (thesis), Chapel Hill University 2015
Film biographique Une Visite avec Darius Milhaud par Ralph Swickard tourné en Californie -
Diva et compositrice: PAULINE VIARDOT-GARCIA – l’âme soeur de Clara Schumann et amie de Georges Sand
Comment s’appellent les Maria Callas du 19è siècle ? Elles sont nombreuses à incarner les parties les plus prestigieuses de l’opéra de leur temps (Halévy – Meyerbeer – Rossini – Verdi – Donizetti – Bellini) : Cornélia Falcon, Marietta Alboni, Adelina Patti, Maria Malibran et sa sœur cadette :
Pauline Viardot-Garcia

Fille d’un couple de chanteurs d’opéra montés à Paris depuis l’Andalousie la petite Pauline aura comme parrains lors de son baptême en 1821 un ténor italien et une princesse russe, une trousse de rapports plus que bienvenus pour une future carrière sur les plateaux internationaux. A 4 ans elle assiste avec ses parents à l’entrée sur scène de sa sœur Maria, son aînée de 13 ans, à l’opéra de Londres. Maria Garcia va conquérir la scène internationale comme talent exceptionnel que ses admirateurs appelleront « La Malibran », une carrière lancée très jeune et brisée par la mort prématurée à 28 ans, quelques mois après un accident équestre.
Comme enfant sa cadette Pauline connaîtra le monde grâce aux engagements de ses parents et de sa sœur : Londres – New York – Mexico, une famille toujours en route. De là probablement ses « instincts bohémiens » dont elle parlera plus tard. Ces premiers contacts avec le monde de l’opéra tient moins de l’émerveillement que plutôt de la frayeur en voyant agir sur scène ces personnages effrayants comme le Commandeur dans Don Giovanni ou le Freischütz avec ses coups de feu. Si le père a mal maîtrisé son tempérament furibond vis-à-vis de Maria qui échappe à son contrôle, il prodigue les soins les plus attentifs à Pauline qui s’en souviendra à l’âge de 39 ans : « Je n’ai éprouvé que de la tendresse de sa part – il m’aimait passionnément et délicatement. Lui qui a été, dit-on, si sévère et si violent avec ma sœur, il a usé d’une douceur angélique avec moi » (dans une lettre à Julius Rietz).
Quant à l’éducation musicale, les premiers éléments lui sont dispensés par son père, et d’abord il faut se mettre au piano. Mais bientôt elle sera prise en main par les professeurs Meysenberg (piano) et Reicha (contrepoint) du Conservatoire de Paris. La mort de son père en 1832 représente pour elle, âgée de 10 ans, une césure. Elle travaille le piano comme une forcenée et deviendra sous peu l’élève de Franz Liszt sous le charme duquel elle perd souvent ses moyens. Liszt admire le talent de sa jeune élève et se souviendra de ces leçons dans la maison des Garcia, priant Mme Viardot 40 ans plus tard de le rejoindre à Weimar.
L’absence du père la rallie davantage à sa sœur aînée Maria qui, s’étant séparée de son mari Malibran vient d’épouser Charles de Bériot, violoniste belge de renommée internationale, pour s’installer dans son palais à Ixelles.
le pavillon construit en 1833 par Charles Bériot pour son amour Maria Malibran
A 15 ans Pauline se produit comme pianiste avec sa sœur et son beau-frère Bériot, suscitant déjà l’admiration d’un large public, même de la part des altesses royales. Après la mort de Maria Pauline et sa mère Joaquina restent près de Charles, le veuf inconsolable. Joaquina a depuis longtemps flairé l’idée d’une carrière de chanteuse pour Pauline, estimant que l’opéra offre des perspectives plus larges que le piano, et dès 1837 la pianiste de 16 ans va éblouir un public de prestige en se produisant comme chanteuse lyrique à Bruxelles, un concert qui lui occasionne des entrées sur scène à Berlin, Dresde, Leipzig et Francfort. Meyerbeer vient l’écouter à Wiesbaden, lui promettant d’écrire un opéra pour elle (ce sera « Le Prophète »), et à Leipzig elle rencontre Clara Wieck, de 2 ans son aînée (qui restera son amie la plus intime jusqu’à la mort de Clara Schumann). Loin du récital de chant de nos jours les concerts d’alors présentaient normalement un pot-pourri où une cantatrice pouvait présenter ses airs d’opéra à côté d’œuvres instrumentales. Les programmes sont établis par son beau-frère Charles qui y participe comme violoniste, et dans un premier temps Pauline Garcia chante le répertoire de sa sœur Maria Malibran qui, elle, avait hypnotisé le monde par sa beauté exotique, tandis que Pauline passe plutôt comme contrôlée, intellectuelle, d’un physique peu alléchant. Le poète Heinrich Heine la trouve « laide, mais d’une sorte de laideur qui est noble. » Est-ce le soupçon d’une bouche légèrement ‘chevaline’ qui explique qu’elle la garde fermée sur tous les portraits ? Néanmoins, la conquête de la scène d’opéra lui réussit à 18 ans à Londres avec le rôle de la Desdemona dans Otello de Rossini, l’un de ses rôles favoris tout au long de sa carrière. Suivront des engagements à Versailles et au Théâtre-Italien à Paris où Théophile Gauthier note après l’avoir entendue : « Elle possède l’un des instruments les plus miraculeux que l’on peut entendre. L’étendue de sa voix est extraordinaire. Elle parcourait deux octaves et une quinte, du F d’un ténor jusqu’au Do’’ du soprano (…) le ton est toujours articulé de façon pure, sans hésitations ni portamento, une qualité rare et précieuse. Elle est une excellente musicienne. » Et George Sand, de retour de Nohant avec Chopin, subit un coup de foudre dans sa loge du Théâtre-Italien :
Pauline Garcia comme Desdemona (artiste inconnu) émerveillée à 35 ans par le jeu et la voix de l’actrice de 18 ans elle s’arrange illico pour faire main basse sur Pauline Garcia qui semble lui correspondre à plusieurs points de vue : son entier dévouement à l’art, son autonomie comme jeune femme qui sait affronter l’hypocrisie du temps etc. Dans son journal intime elle note : « Il me semble que j’aime Pauline du même amour sacré que j’ai pour mon fils et ma fille, et à cette tendresse indulgente, illimitée, presque aveugle, je joins l’enthousiasme qu’inspire le génie. » En voilà un amour, une complicité entre deux femmes d’âges différents dont va témoigner une riche correspondance entretenue jusqu’à la mort de l’écrivaine. Comme George Sand reçoit chez elle l’élite du monde parisien elle a beau jeu de mettre sa protégée en relation avec les gens influents. Voyant comment le poète Alfred Musset se démène pour conquérir la cantatrice elle se jure de protéger son amie contre les avances de ce dévergondé notoire, en initiant un manège pour la rapprocher à Louis Viardot, le directeur du Théâtre-Italien, l’un des habitués de ses dîners, un homme de grande culture, ami également de la mère de Pauline. Son âge de 40 ans ne semble point effaroucher la cantatrice – et les noces ont lieu le 8 avril 1840.
Musset, le poète répudié, se vengera avec la publication de caricatures dans la presse. Dans ses critiques il entonne d’abord le cantique des cantiques sur La Malibran, sa chanteuse fétiche d’antan, pour adopter ce ton acerbe sur la Desdemona de Pauline Viardot : « Ce n’est plus la belle guerrière, c’est une jeune fille qui aime naïvement et qui voudrait qu’on lui pardonnât son amour, qui pleure dans les bras de son père… » . Le couple Viardot part en voyage de noces à Rome où les deux tombent sur le boursier Charles Gounod et le couple Fanny et Wilhelm Hensel-Mendelssohn également de passage en Italie. Ce séjour les comble de bonheur. D’une relation purement professionnelle au départ ils découvrent leur union affective dans un décor bucolique. Le mari se laisse véritablement emporter dans une lettre de gratitude adressée à leur ’entremetteuse’ George Sand : « A Paris nous vous nommions notre bon ange, n’est-ce pas ? Eh bien, il ne se passe pas de jour que nous ne vous adressions une prière de remerciement… ».
De retour à Paris Louis Viardot quitte son poste de directeur, se consacrant corps et âme comme imprésario privé à la carrière de sa jeune épouse dont la place privilégiée aux ‘Italiens’ sera minée dorénavant par sa rivale Giulia Grisi qui, elle, se félicite de du départ de Viardot. Suite à des querelles autour du plateau et aux déboires que son mari s’est attirés dans ses engagements politiques la carrière parisienne semble péricliter, ce qui pousse les Viardot à tenter la chance hors du pays. Pourquoi pas L’Angleterre, le pays où sa sœur Maria avait remporté ses plus grands succès et où elle est morte après une représentation à Manchester ? Quand Pauline chante du Cimarosa, du Mozart ou du Rossini à Londres, elle ne le fait pas avant d’avoir étudié avec minutie les textes et leur contexte littéraire (p. ex. Shakespeare pour ‘Otello’), ce qui n’avait point préoccupé le tempérament volcanique de sa sœur Marie. A partir de ses débuts londoniens la jeune diva navigue entre Paris, Madrid, Vienne, Prague, Berlin et Leipzig. Les ovations les plus trépidantes lui sont réservées en 1842 à Madrid et à Grenade, dans le pays de ses origines, où elle se fait rappeler interminablement et bombarder avec des fleurs dans le palais somptueux de l’Alhambra.
Alhambra, Cour des Lions (gravure du 19e siècle) Le critique de la revue culturelle se perd dans les superlatifs : « Quelle manière de chanter ! quel bonheur ! quel goût ! quelle méthode ! quelle voix si moelleuse, si harmonieuse, si agréablement sensible ! quelle extension ! quelle égalité ! quels graves ! enfin, quel ensemble ! On ne peut pas faire mieux ». A noter que l’élite espagnole apprécie en plus la venue de son mari Louis Viardot, connu ici pour ses travaux sur l’art et la littérature espagnole et pour son excellente traduction de Don Quichotte. De son volet andalous la compositrice nous laissera quelques mélodies dont la fameuse Havanaise publiée en 1880 pour deux voix qui, dans les dernières mesures, font éclater leurs guirlandes de triolets virtuoses et mutuellement entrelacés. – Lors d’une première tournée avec le rôle de Norma à St-Pétersbourg elle rencontre le poète Ivan Tourguéniev en novembre 1843, un moment charnière de sa vie, d’où ses fréquentes incursions dans la capitale russe au cours des décennies pour des rencontres avec son amant russe qui, par la suite, ne refusera pas l’idée d’un ménage à trois avec le couple Viardot dont Pauline se porte garante d’une gestion bravoureuse. Avec les cachets mirobolants de ses concerts à St-Pétersbourg elle peut s’offrir – à 23 ans ! – le château Courtavenel en Seine-Marne où elle se retire périodiquement pour recevoir ses amis les plus proches.

Ivan Tourguéniev Parmi les dates mémorables de la carrière retenons la nouvelle rencontre avec Clara Schumann à Vienne en mars 1844 et les futurs concerts en commun avec elle en 1858 en Hongrie et en 1870 à Bade, le Requiem de Mozart chanté le 30 oct. 1849 lors des funérailles de Chopin à Paris, ses engagements sous la direction de Berlioz vers la fin des années 1850, son installation à Baden de 1863 jusqu’à la guerre franco-prussienne de 1871, le poste de professeure au Conservatoire de Paris en 1872, l’acquisition du domaine des Frênes à Bougival, le décès de George Sand le 8 juin 1876, l’amie intime à qui elle devait tant, la mort de son mari Louis et de Tourguéniev la même année 1883, les rencontres avec Tchaïkovsky de 1886 et 1889 et la création de son opérette Cendrillon en 1904.

La villa Viardot nouvellement restaurée à Bougival (la datcha de Tourguéniev se trouvant tout près)
La diva acclamée dans les capitales européennes et célébrée dans la presse de son époque – la compositrice d’œuvres remarquables pour la scène – la salonnière qui réunit autour d’elle à Bougival, à Paris et à Baden la crème littéraire et musicale :
Lequel des labels la définit le mieux pour la postérité ?
Dans les jours de relâche entre deux engagements la cantatrice se penche sur les papiers à musique pour développer ses mélodies ou ses lieder. A 17 ans ses talents de compositrice sont déjà reconnus par Robert Schumann qui lui consacre un article dans sa « Neue Zeitschrift für Musik » de 1838 : « Le Lied est étrange, composé comme lied allemand par une Espagnole, puis étoffé et parachevé de l’intérieur. La musicienne a su dépeindre la vision du poète jusqu’aux plus tendres détails en y introduisant du sien propre. » – Ivan Tourguéniev qu’elle rencontre à 22 ans lui fera découvrir la poésie russe d’une part et la mettra en contact avec Eduard Mörike, son poète allemand favori.
Dans Fleur desséchée de Pouchkine le poète découvre entre les pages d’un livre une fleur desséchée dont il s’imagine la splendeur avant qu’elle ait été arrachée, se demandant quels amoureux s’en sont emparés. La voix du soprano suit le rythme des paroles, une sorte de récitatif équilibré où le piano se limite aux accords discrètement apposés et réitérés au rythme du battement d’une pendule.
Quant aux adaptations musicales de Mörike la réception retiendra surtout les trois Lieder In der Frühe, Nixe Binsefuss et Der Gärtner – publiés en 1870 à Weimar. Nixe Binsefuss appartient au cycle des légendes autour de la figure de l’Ondine et du Pêcheur. Dans la version de Pauline Viardot l’ondine, dansant sur la glace, affronte le pêcheur sur un ton enjoué, voir moqueur. Ce lied, une ballade tripartite s’introduit par quelques mesures presque prosaïques du piano qui figure l’ondine qui émerge des profondeurs pour se mettre à danser :
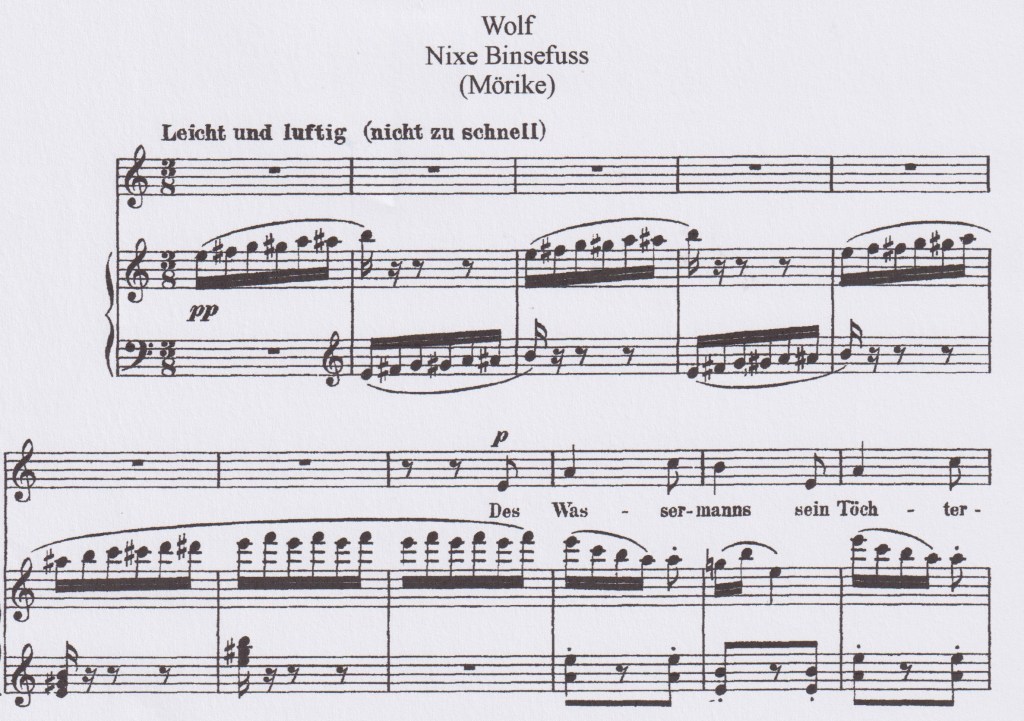
Si le piano suggère ici à gauche la danse de l’ondine, la version de Hugo Wolf de 1888 associe initialement plutôt le clapotis des vagues. Par ailleurs la musique de la Viardot s’articule dans une option scénique, la cantatrice du lied rejoint le rôle de l’actrice. De là les effets burlesques quand l’ondine va rire au nez du pêcheur, sauts de grands intervalles et trille à l’appui (« viens seulement avec tes filets ! Je vais te les déchiqueter ! »), tandis que chez Wolf cette phrase provocatrice s’intègre dans le mouvement continu des vagues :


Sauts et trille chez Viardot (à gauche) – déferlement des vagues chez Wolf (à droite).
Ce côté narquois nous le trouvons d’autant plus fréquemment dans les œuvres scéniques de Pauline Viardot, avant tout dans l’opérette Le dernier Sorcier sur un texte de Tourguéniev, un drame féérique composé en version orchestrale, mais également comme réduction au piano pour les besoins du salon. Les exécutions entre 1867 et 1770 à Weimar, Baden et Karlsruhe ont suscité des réactions mitigées. Certains critiques s’amusent à houspiller le spectacle ennuyeux, d’autres reconnaissent un certain talent de la part d’une « dilettante« , mais en général l’on s’accorde sur la réussite du chœur des Elfes, un genre bien connu depuis Weber ou Mendelssohn. Il est bien évident que les remarques désobligeantes dans la presse allemande de 1870 relèvent du mépris pour les artistes du pays que l’on vient d’occuper. Sans tarder Tourguéniev publie dans les « Sankt-Petersburger Nachrichten » une apologie de la musique de son amie – et peu après il va rejoindre Paris et s’installer au dernier étage de la maison des Viardot, où le poète russe reçoit chez lui le gratin de la littérature : Les Goncourt, Sainte-Beuve, Flaubert, George Sand, Zola, Daudet et Flaubert. Au salon du Bel Étage Pauline reçoit des exilés russes et organise des concerts consacrés à la Russie – tout cela encore avant que les Viardot occupent la résidence « Les Frênes » à Bougival en 1875.
A part Le dernier Sorcier la compositrice a mis en musique deux autres textes de Tourguéniev : Trop de Femmes et L’Ogre, mais avec peu de répercussion. Son seul véritable succès représente sans doute l’opérette Cendrillon de 1904, une œuvre tardive sur un conte de Perrault et créée par la compositrice à l’âge de 83 ans dans son dernier salon parisien.
La version de Perrault a déjà servi de base à la Cenerentola de Rossini (1817) que Pauline Viardot a d’ailleurs chantée en 1859 à Leipzig. Elle dote Cendrillon d’une atmosphère mi-drôle mi-mélancolique. Sa chanson initiale « Il était jadis un prince… », une mélodie folklorique, ouvre l’opérette, chantée sans accompagnement et interrompue tout le temps par des considérations parlées sur le bien-fondé du conte dont parle la chanson – des intrusions insolites typiques pour notre compositrice :
Au bout de quelques manèges Marie la servante (Cendrillon) se retrouve – comme il se doit – avec son prince (déguisé au départ en mendiant, puis en valet) sur le parquet d’un bal où les deux articulent mutuellement leurs effusions amoureuses dans le duo qui passe pour le point culminant de la pièce. L’air synchronisé sur les paroles « Mon âme ravie rayonne de bonheur. Depuis que je vous vis je vous donnai ma vie » nous rapelle de loin le fameux duo entre Adam et Ève « Holde Gattin, Dir zur Seite… » (no. 32) dans La Création de Haydn, sauf que la Viardot ne peut s’empêcher ici de démystifier malicieusement ce moment céleste…en faisant suivre le pianissimo « réunis à jamais » exhalé, les paupière closes, par un coup fracassant des timbales – comme pour dénoncer le kitsch de la scène :

Pour finir la famille se verra obligée de s’excuser auprès du prince pour avoir marginalisé leur petite sœur Marie avant que surgisse la Fée qui vient bénir le bonheur du couple.
Pauline Viardot a entretenu plusieurs correspondances de longue durée. A coté de celle avec Clara Schumann ou avec George Sand il faut relever surtout les innombrables lettres échangées avec Julius Ritz.

Julius Rietz (dom. publ.) Les deux se sont connus en février 1858 lors d’un concert commun au Gewandhaus à Leipzig : Rietz le violoncelliste, chanteur, pianiste et chef d’orchestre – Viardot la cantatrice et pianiste. Leur compréhension mutuelle est immédiate et les 150 lettres entre 1858 et 1874 témoignent d’un profond respect sur leurs conceptions mutuelles et d’une amitié enrichissante tout au long de ces années. Pauline s’étend longuement sur le processus de ses compositions et Rietz suit le travail de son amie de près. Les encouragements peuvent toutefois admettre des critiques bienveillantes comme p.ex. celle sur les Lieder sur Mörike où Rietz diagnostique quelques faiblesses dans l’harmonie et les mélodies.

Bd. St-Germain 243, Paris 
Place commémorative Après la mort de son mari et celui de Tourguéniev en 1883 les lettres de Pauline Viardot sont encadrées en noir. En tant qu’héritière principale de la succession de Tourguéniev elle est impliquée dans un procès contre d’autres héritiers. Dans sa dernière résidence au 243 du boulevard St-Germain elle reçoit régulièrement Tchaïkovsky qui la caractérise dans une lettre à une amie russe : « De toutes les connaissances que j’ai faites c’est celle de Mme Viardot qui m’a laissé la plus charmante impression. Elle est pleine de vie, elle montre de l’intérêt à tout, s’y connaît et se donne très accueillante. »
Son âge avancé ne l’empêche pas de continuer la tradition du salon : les convives affluent vers 22.00 heures et l’on fait de la musique jusqu’à minuit, suite à quoi l’hôtesse distribue des gâteaux, des sandwichs et du thé – avant qu’on rentre vers 03.00 heures.
Pauline Viardot chantant à l’orgue de son salon précédent rue de Douai La musicienne accompagne encore quelques élèves et continue de composer. Au théâtre du Châtelet on donne en 1892 son Rêve de Jésus en création avec une de ses élèves comme soliste. La cantatrice Mathilde de Nogueiras, son élève, à qui la compositrice a dédié Cendrillon va créer l’opérette en 1904 et restera auprès de son ancienne professeure jusqu’à sa mort.

photo en frontispice de la particion de Cendrillon: Marie (Cendrillon: Mathilde de Nogueiras) humiliée au 1er acte par l’une de ses soeurs
Le jour de la mort le 18 mai 1910 sa fille Hériette se trouve à ses côtés. Son récit parle d’une mort douce, paisible : « Notre mère est décédée doucement dans nos bras. Deux jours avant sa mort elle a dit tout à coup : ‘J’ai encore deux jours à vivre !’ (…) Depuis ce moment elle n’a plus parlé, mais elle a gesticulé en souriant. Elle s’est sans doute remémorisé les scènes de son passé, de ses succès (…), car la seule parole qu’elle a sortie était « Norma ! ».

La tombe de Pauline Viardot au cimetière de Montmartre, pas très loin des sépultures de J. Offenbach ou de H. Berlioz. Le colosse en granit semble symboliser la solidité de sa personnalité, sa façon terre-à-terre de gérer sa vie.
S O U R C E S :
Patrick Barbier, Pauline Viardot – Biographie, Grasset, Paris 2009
Beatrix Borchard, Pauline Viardot-Garcia, Fülle des Lebens, Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2016
Beatrix Borchard + Miriam-Alexandra Wigbers, Pauline Viardot – Julius Rietz, Der Briefwechsel 1858-1874, Georg Olms Verlag, Hildesheim/Zürich/New York 2021
Barbara Kendall-Davies, The Life and Work of Pauline Viardot Garcia, Scholars Press, Cambridge 2003Émissions radiophoniques en français, en allemand, en anglais et en italien
E N R E G I S T R E M E N T S :
Les oeuvres citées sont toutes disponibles sur youtube -
Gabriel Fauré à Lugano: l’Ithaque de son opéra ‘Pénélope’

l’île d’Ithaque (Grèce) 
Hôtel Métropole en 1911 à Lugano Surchargé comme directeur du Conservatoire de Paris Gabriel s’offre une série de séjours lacustres en Suisse, du Lac Léman (à Lausanne) au Lac Majeur (à Stresa), avant de rejoindre Lugano, le site qu’il fréquentera régulièrement entre 1909 et 1913.
La correspondance quotidienne avec sa femme et – à l’abri de cette dernière – avec sa maîtresse nous fait part de son enthousiasme face à un décor méditerranéen depuis sa chambre donnant sur la baie, et de la progression de ses compositions.
Ces étés à Lugano ne sont pourtant pas son premier contact avec la Suisse : En 1882, lors d’un séjour à Zurich en compagnie de son maître Saint-Saëns il est témoin du culte que l’on semble vouer au star du festival en cours : Franz Liszt. Dans une lettre à Mme Clerc il avoue : « D’abord j’ai vu Liszt et ce n’est pas sans émotions ! Saint-Saëns prétend que j’étais vert quand il m’a présenté à son illustre ami. »

La rive d’Ouchy-Lausanne autour de 1900 (©Jean Riston)
En 1903 Fauré, venant de Thonon-les-Bains, se retrouve à Lausanne où il reprend les ébauches de son 1er Quintette avec piano, une œuvre souvent abandonnée et finalement reprise pour de bon à Zurich en 1904.
Seraient-ce les promenades au bord des lac Léman ou de Zurich, sous la brise ourlant les vagues qui auraient inspiré ces accords brisés introductifs du piano ?

La finale présente un ‘rondo’ en forme de sonate qui tourne autour du seul thème principal dont Philippe, le fils de Fauré, croit entrevoir un écho de la finale de la 9e symphonie de Beethoven.

finale du quintette 
Beethoven 9e symphonie C’est également à Zurich que Fauré écrit l’année d’après sa ‘Barcarolle’ No. 7, une pièce qui annonce le style ‘tardif’ du compositeur, un abandon de l’ornementation surchargée, une réduction de la structure qui fait ressortir d’autant mieux la limpidité de la composition et qui d’ailleurs va de pair avec la voie vers l’abstraction dans la peinture chez un Cézanne (les cubes), un Piet Mondrian les carrés), un Kandinsky (le mouvement), sans parler de la mise en question de la tonalité depuis Debussy : la mélodie vogue le long d’une ligne chromatique serrée soutenue par le gouttelettes de la main gauche qui semblent brouiller la piste des tonalités.

mesures 3-8 de la barcarolle no. 7
De 1906 à 1908 Fauré fréquente souvent les sites lacustres suisses: Lucerne et Vitznau au pied du Rigi (Le Don Silencieux), Stresa au Lac Majeur (« Paradis » du cycle La Chanson d’Ève et Pénélope), et trois fois Lausanne où il achève en 1908 sa 10e Nocturne, une pièce pleine d’accords de transition le long d’un parcours chromatique :
Ces séjours en Suisse sont ponctués d’activités accessoires comme pianiste ou au pupitre pour diriger ses propres œuvres. En plus Fauré y rencontre des collègues qui resteront ses amis comme Isaac Albéniz (à Zurich) ou Paul Dukas (à Lausanne).
Les jours consacrés exclusivement à la composition Fauré les trouvera enfin à Lugano où il arrive le 19 juillet 1909 : « Je suis arrivé hier soir et je suis descendu pour la nuit près de la gare, à l’hôtel d’où je t’écris. Et comme cet hôtel me paraît tout à fait bien (Grand Hôtel Métropole), j’ai choisi, pour le séjour, une belle et assez grande chambre avec terrasse, d’où la vue sur le lac, les montagnes et la campagne très verte, est superbe. » Les lettres quasi quotidiennes à sa femme parlent minutieusement de son travail qui progresse ou qui peine, c’est selon. A côté de quelques ébauches pour le cycle d’Ève il s’agit avant tout de mettre au point le ‘Prélude’ de Pénélope (le sujet de cet opéra lui a été suggéré par la diva Lucienne Bréval, et Fauré a mis la composition en chantier en 1907/1908 à Lausanne).

Fauré dans sa chambre d’hôtel, penché sur une page de ‘Pénélope’ – ou sur une lettre à sa maîtresse ? © BnF (archive Marguerite Hasselmann)
A en juger les lettres de Lugano Fauré semble prendre un vif plaisir à orchestrer ces parties de Pénélope, conscient toutefois des problèmes des opéras d’après-Wagner dont il adopte le principe du leitmotif, tout en évitant de noyer le chant dans des sonorités épaisses. Suite aux centaines de lieder composés auparavant Fauré réussit à donner aux parties solistes la clarté de la diction. L’intelligibilité du texte lui tient à cœur.

Pénélope languissante en train de filer (dom. publ.)
Le ‘Prélude’ s’ouvre sur le thème de Pénélope, un début languissant qui exprime l’âme triste de la protagoniste qui attend le retour de son amour (voir la chanson de Solveig dans ‘Peer Gynt’ de Grieg), un thème entrecoupé de pauses et marqué par des figures doublement pointées qui se condenseront dans un crescendo dramatique jusqu’au surgissement du thème d’Ulysse, une espèce de fanfare à la trompette soutenu par le trémolo des cordes :

Début du Prélude : thème de Pénélope dans les cordes
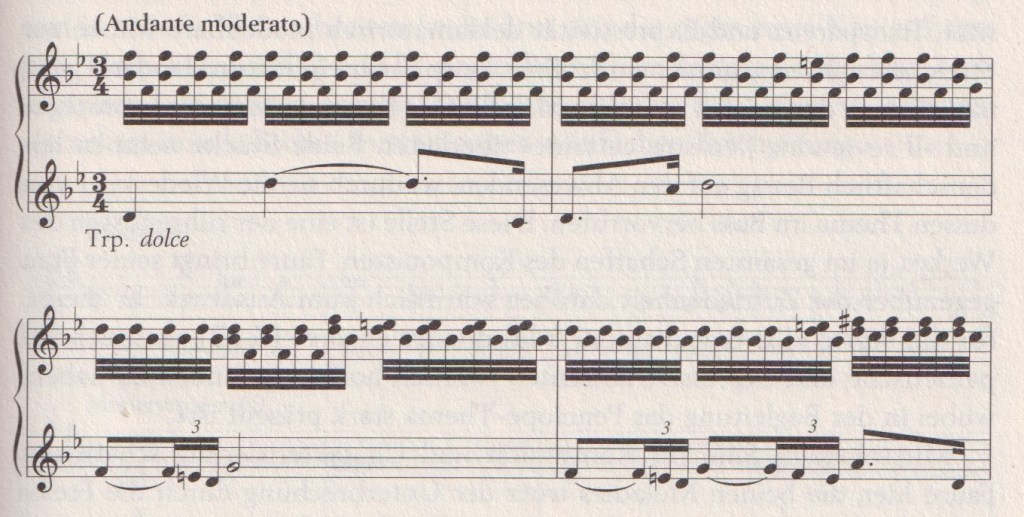
Prélude : thème d’Ulysse à la trompette
Soucieux d’équilibrer la matériel thématique Fauré en parle à sa femme : « Je n’ai plus qu’un page à orchestrer du ‘Prélude’. Cela me fera 28 pages d’orchestre. Mais c’était la partie délicate ; il fallait trouver les sonorités propres à créer l’atmosphère du drame… » A ce propos il disserte dans ses lettres sur l’essence de la musique française : « Nous sommes par l’esprit de descendance grecque et latine. Nous aimons la clarté et nous voulons l’agrément dans la forme. Nous sommes des stylistes (…) la faveur ne reste qu’aux œuvres irréprochablement écrites (…) nous sommes les peuple du goût en toute chose. » Et ailleurs : « La polyphonie excessive de Wagner, les clairs-obscurs de Debussy, les tortillements bassement passionnés de Massenet émeuvent ou attachent seuls le public actuel. Tandis que la musique claire et loyale de Saint-Saëns dont je me sens le plus rapproché, laisse ce même public indifférent. »
Au 1er acte la musique excelle par un arioso cristallin là où Pénélope chante son « Jadis quand on aimait » : une cantilène sans chromatisme et soutenu par le tapis discret des cordes :

Le 2e acte s’ouvre sur un tableau bucolique, la baie de Lugano suggérant la rive d’Ithaque, suivi par le dialogue entre Pénélope et Ulysse revenu, déguisé en mendiant. Dans quelle mesure la scène lui pose des problèmes Fauré le confie à sa maîtresse Marguerite Hasselmann dans une de ses lettres envoyées depuis son hôtel (dont le ton diffère décidément de celui des missives à sa femme) : « Oui, mon chéri, je serre tant que je peux, en la faisant le plus musical possible, le sacré et falot dialogue ! … Le texte est très rasoir ! Mais il est nécessaire… Je m’étais installé devant ma table avec la résolution assez noble de m’occuper de cette brute d’Ulysse et de ses alexandrins gênants et embêtants, lorsqu’on m’a apporté les journaux et…ta lettre ! Alors quelle joie ! »
(Cet amour ‘clandestin’ pour Marguerite H., fille du professeur de harpe et pianiste, cadette d’une génération et rivale de Marguerite Long, la vedette du piano de l’époque qui se considérait dépositaire de l’œuvre pianistique de Fauré, durait jusqu’à la mort de Fauré.)

Pénélope et Ulysse réunis (lithogr. de peintre inconnu)
L’opéra se conclue par le triomphe d’Ulysse sur les trois prétendants qui vont payer de leur vie leur ambition d’épouser Pénélope. La rage du mendiant ayant dévoilé son identité domine l’avant-dernière scène où les cuivres font résonner leur accord haché en ré-mineur avant que le thème royal d’Ulysse – déjà entendu dans le ‘Prélude’ – retentisse dans les coulisses. Le massacre des trois rivaux mène le couple de nouveau réuni vers le bonheur de leur vie conjugale retrouvée. La parole « Gloire à Zeus » chantée en chœur par les servantes et les bergers, escortée par les sauts d’octaves et de quintes (thème d’Ulysse roi) dans l’orchestre aboutit à un majeur rayonnant, céleste et déposé en pianissimo.

les îles Borromées devant la rive de Stresa Quant au cycle des lieder de La Chanson d’Ève sur la poésie symboliste de Van Lerberghes, Fauré en pose la première pierre le 13 juin à Stresa, où le clapotis de la rive lui inspire son « Crépuscule » un lied qui baigne dans l’atmosphère idyllique du site lacustre. Jankélévitch définit ici le thème « édénique » comme reprise de la fin de ‘Pelléas et Mélisande’, thème développé et continuellement repris dans la partie du piano :

Thème au piano entre la quinte ré-la et si-bémol-fa’ sur « ce son dans le silence »
Les autres numéros du cycle seront composés entre Lausanne et Lugano de 1906 à 1910. Dans « Paradis », le premier lied du cycle le chant s’élève au-dessus de quelques touches limpides du piano, des blanches apposées dans une lenteur qui suggère la pureté d’un univers préservé.
Quant à « L’Aube blanche » Jankélévitch y trouve le moment de l’éveil, la naissance de la vie, une musique pleine d’harmonies « serrées » qui glissent l’une dans l’autre sans transition et – contrairement à la métaphore de l’éveil le chant et la basse suivent leur parcours chromatique descendant, les harmonies faisant de même : d’un la majeur on aboutit finalement sur mi-bémol mineur, quelques blanches pour le frottement de la septième majeur :

Notre vieillard de 65 ans frappé d’un début de surdité est profondément attiré par cette poésie symboliste sur les débuts de la vie au paradis. Rien d’étonnant à ce qu’il se sente rajeuni depuis qu’une certaine Marguerite de 35 ans est entrée dans sa vie. Ses lettres en disent long : « Il fait beau le matin, quand je m’étire dans mon dodo !… Mon enfant chéri, encore six jours ! C’est beaucoup trop, à mon goût ! Je t’envoie un million des plus douces, des plus tendres, des plus profondes caresses ! Je t’adore, mon bien aimé oiseau » (de Londres en 1908).
A Lugano Fauré est loin de se calfeutrer dans sa chambre d’hôtel. IL sillonne joyeusement les collines verdoyantes avant de s’installer dans son café habituel pour prendre son thé. De plus il est sollicité par la bonne société mélomane qui se réunit deux fois par semaine au château de Trevano près de Lugano. Louis Lombard, la patron et musicien amateur dirige dans la salle de sa demeure les œuvres de Fauré, sa fille y joue à 4 mains avec le compositeur et on finit ces concerts privés autour d’un dîner copieux. Mais à la longue ses invitations lui pèsent, préoccupé par ses compositions en cours (‘Pénélope’, oeuvres pour piano, la fin de ‘La Chanson d’Ève’) et par l’épée de Damoclès de sa surdité progressive.

Fauré avec la fille de M. Lombard à Trevano A propos de l’œuvre pianistique Fauré fait part de sa vision dans une lettre de Lugano à sa femme (2 août 1910) : « Dans la musique pour le piano, il n’y a pas à user de remplissage, il faut payer comptant et que ce soit tout le temps intéressant. C’est le genre peut-être le plus difficile, si l’on veut y être aussi satisfaisant que possible…et je m’y efforce. »
Comment ses nocturnes, ses préludes, impromptus et barcarolles vont-ils se démarquer du style de Saint-Saëns d’une part, de Debussy de l’autre ? Et quel en sera l’impact sur ses élèves Ravel ou Koechlin ?
Depuis que la surdité a progressé la composition et l’exécution de ses pièces pour piano lui causent de plus en plus de douleurs. Il dit qu’il n’entend les notes médianes plus que de loin, et que les aigus ainsi que la basse lui font mal aux cheveux. – Dans ces œuvres tardives Fauré sait éviter les sonorités doucereuses du salon de ses années de jeunesse, au profit d’une rigueur qui gagne en intensité. La Barcarolle no. 9 en la-mineur op. 101 commencée en 1908 – comme d’ailleurs le Nocturne no. 10 de la même année – frappe par la sobriété de moyens et la retenue de l’expression. Au lieu d’enchaîner des accords du genre « mille feuilles » comme chez Liszt ou les Russes, Fauré dessine clairement l’humble cellule thématique soutenue par quelques accords allégés et syncopés, une harmonisation sans « remplissages » (cf. la lettre à sa femme). Les 20 premières mesures répandent ainsi une atmosphère mélancolique qui rappelle le genre ‘nocturne’, avant que le thème prenne de l’erre, propulsé par le jeu des gammes et arpèges suggérant les vagues que la barque va sillonner de travers :

Cellule thématique du début en la-mineur

Thème enlacé par les arpèges
La barque ayant accosté à bon port, le thème initial s’articule en pp dans les graves à l’intérieur de l’accord en la-mineur tenu comme point d’orgue.
A Lugano Fauré compose en 1909 et 1910 ses 9 Préludes op. 103, l’année des ‘Préludes’ de Debussy. Fauré fait preuve ici de concision, ses préludes de brève durée se distinguent par une richesse d’éléments polyphoniques et de surprises harmoniques, dans l’ensemble un kaléidoscope du potentiel de la composition faurienne.
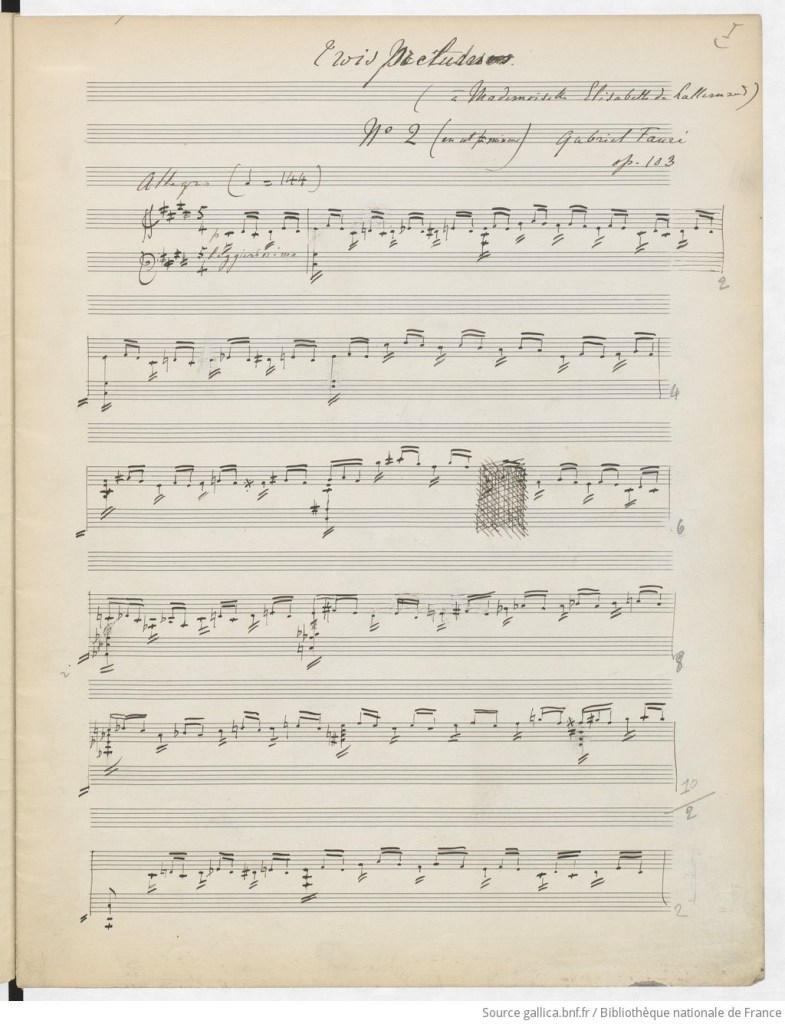
début du 2e prélude de l’op. 103 S O U R CE S :
Jean-Michel Nectoux, Fauré – seine Musik, sein Leben, Bärenreiter-Verlag, Kassel 2013
Gabriel Fauré, Correspondance, éd. Fayard, Paris 2015
Gabriel Fauré, Lettre intimes, éd. Du Vieux Colombier, Paris, 1951
Vladimir Jankélévitch, Gabriel Fauré, ses mélodies, son esthétique, éd. Plon, Paris 1938
Louis Vuillemin, Gabriel Fauré et son œuvre, éd. Durand et fils, Paris 1914
Fabio de Luca, Gabriel Fauré – le sue estate a Lugano, émission de la télévision suisse-italienne de 2022
D I S C O G R A P H I E :
Quintette no. 1 avec piano : Fauré – Quintettes no. 1 et 2, Auryn Quartett + Peter Orth
CD 1997 (NDR) – youtube (audio)
Pénélope : Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Charles Dutoit, youtube (audio)
Youtube avec partition sychronisée (SP Score Video)
La Chanson d’Ève : 4 youtubes : Elly Ameling (audio+partition synchronisée) 1974,
Jane Sheldon (film),
Janett Shell (audio),
Dawn Upshaw (audio)
Œuvres pour piano : Fauré – Complete Music for solo piano, Lucas Debargue (Sony Classical), Fauré – L’intégrale des pièces pour piano, Germaine Thyssens-
Valentin, 1955-1956, Coffret (CMRR) : youtube (audio),
Fauré : Nocturnes et Barcarolles, Marc André Hamelin, 2024
Double Album (Hyperion)
-
Lise Cristiani de Paris – première violoncelliste en tournée vers les steppes russes
Une ruelle d’un quartier mal famé à St-Denis : c’est à l’étage d’une bicoque qu’est née Élise Chrétien en 1825 (et non en 1827 comme le préconisent de nombreux commentaires).


Son grand-père Alexandre a réalisé le portrait de la violoncelliste qu’il va afficher partout, si bien que le public afflue en grand nombre dont la curiosité se dirige moins vers la qualité de ses interprétations que vers la façon d’arranger sa pose sur scène. Les premiers critiques soulignent son apparition grâcieuse et l’élégance féminine de son jeu et le succès de cette première série de concerts lui permet de s’offrir son propre Stradivarius pour 7000 francs, un instrument joué à l’époque par Jean-Louis Duport.
Non seulement le choix de son instrument est quasiment une transgression des normes, mais aussi son idée de se lancer toute seule sur le parcours d’une tournée internationale. Après quelques arrêts à Rouen et à Bruxelles en 1845 elle va miser sur le 2ème centre musical en Europe : Vienne. La presse annonce ses entrées sur scène en avertissant le public : « Une femme au violoncelle – c’est le comble ! » En arrivant la Christiani organise elle-même les concerts, se mettant à la recherche de musiciens sur place pour établir les programmes qui consistent en général en un potpourri de mélodies tirées d’opéras connues (les ‘tubes’ de l’époque), de pièces originales à l’accompagnement du piano (Offenbach, Franchomme) ou d’arrangements pour des formations de chambre. – Les échos positifs dans les journaux l’encourage à s’arrêter dans plusieurs villes de l’Allemagne du sud avant de se diriger vers Leipzig où elle pourra conquérir le fameux « Gewandhaus ». Arrivée en octobre 1846 elle s’y voit soutenue par les grands musiciens du lieu comme Joachim, Gade ou Reinecke, mais avant tout par Mendelssohn, le directeur actuel du Gewandhausorchester, qui l’accompagne au piano et se dit fortement impressionné par son jeu. Et le résultat de cette rencontre mémorable : La « Romance sans paroles » op. 109 « dédiée à Mlle Lise Cristiani » :
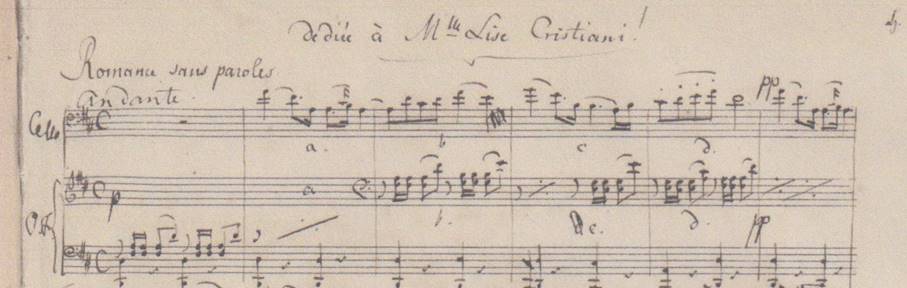
autographe de la composition, publiée posthume comme « Lied ohne Worte » (d. publ,)
Son voyage la conduit ensuite à Berlin où elle joue à la « Singakademie » et devant le roi, avant de zigzaguer à travers l’Allemagne entre Hambourg et Francfort/Oder dans une dizaine de villes. A Copenhague le roi du Danemark la nomme « virtuose de la Cour ». Suivront des concerts en Suède avant son retour en Allemagne du nord. – Les critiques allemands lui attestent son jeu grâcieux « loin des manières excentriques et des tours de force des nombreux virtuoses modernes ». Lise Christiani privilégie d’ailleurs un répertoire qui lui permette de déployer le chant lyrique sur les deux cordes supérieures et l’escalade dans les aigus jusqu’au flageolet. Son instrument ne crache jamais d’attaques sur la corde de do, en évitant ainsi de faire ressortir la masculinité du violoncelle. Le presse parisienne s’est permise déjà en 1845 des commentaires narquois sur ses premières entrées sur scène : « …nous ne pouvons guère l’inviter à jouer cet instrument d’une façon large, sévère ; à attaquer vigoureusement les cordes basses au lieu de miauler comme une jolie petite chatte blanche des ‘prières’ et des ‘boléros’ (…) ce qu’il faut conseiller à mademoiselle Christiani, c’est de dire sur le violoncelle une tendre et douce romance en la mineur sur la corde la, de lever les yeux au ciel pour se donner un air de sainte Cécile se préparant au martyre, et son succès sera alors pyramidal » (Revue et Gazette Musicale). Et la « Berliner Musikzeitung » de 1845 va dans le même sens : « Elle traite son instrument décemment et non avec la force, mais avec une grâce et élégance d’autant plus grande. » Et le « Magazine pour la littérature de l’étranger » de 1845 estime qu’ « elle semble davantage soutirer les sons à son instrument plutôt que de les en dégager d’une main ferme (…) son charme est sa féminité qu’elle a su mettre en valeur, comme dans la ‘Prière’ d’Offenbach, dans la ‘Romance’ de Donizetti et dans la ‘Musette’ du 17e siècle. »


« Prière » et « Boléro » de Jacques Offenbach – le cheval de bataille de la violoncelliste
En 1846 elle se lance dans une nouvelle tournée. Loin d’être une Sainte Cécile elle affronte ses aventures avec témérité en mettant le cap sur St-Pétersbourg, en passant par la Pologne et le nord du Balticum. La capitale russe est une ville recherchée par tous les musiciens itinérants, disposant d’un public cultivé et connue pour les honoraires généreux.

le théâtre Blochoï en 1886 Elle joue devant la Tsarine Elisabeth et – n’ayant pas froid aux yeux – elle loue à ses propres frais 2 fois le théâtre Bolchoï – un fiasco : les rangs restent vides : c’est que le régime a décrété peu avant un deuil national, ce qui veut dire interdiction des spectacles ! – L’escale de Moscou (2 concerts) la met en contact avec des officiers. Charmée par ces beaux uniformes elle propose de se joindre à leur expédition militaire vers la Sibérie, une aventure qui va s’étendre sur plusieurs années. A commencer par Ekaterinbourg ses 40 concerts se répartissent sur une douzaine de villes de l’ouest à l’est du fin fond de la Russie orientale.

le théâtre d’Ekaterinbourg au 19e s. / au 20e s.
Le gouverneur d’Irkoutsk propose à l’artiste d’accompagner son expédition imminente vers les extrémités à l’est du pays, un parcours plein d’écueils dont elle parle dans ses propres écrits. La caisse en fer forgé de son Stradivarius solidement brêlée au flanc d’un cheval « je le suivais triomphalement perchée sur une selle de Cosaque, manteau noué au cou, moustiquaire rabattue, la pluie sur le dos et la rivière sous les pieds. Jamais violoncelle de si noble race ne s’est trouvé à pareille fête », l’instrument qu’elle appelle jalousement « mon mari fidèle ». Le voyage à travers ces contrées glaciales (minus 40 degrés) lui demande les dernières énergies. Elle avance en calèche, en luge, en bateau sur les fleuves, à la limite sur des chars attelés. Dans ses lettres à sa famille elle dit un jour qu’elle ne voit « rien que de la neige, des steppes sans fin où l’on se porte soi-même à la tombe. » – Puis c’est la traversée de la mer d’Okhotsk vers la péninsule de Kamtchatka.

La presse allemande cite un concert offert gratuitement au public du Kamtchatka dans la résidence du gouverneur à Petropavlovsk. Elle confirme d’avoir vu des endroits « où jamais artiste n’était encore parvenu ».
En 1850 nous retrouvons la violoncelliste à Moscou d’où elle repart pour l’Ukraine pour jouer à Charkiv, Tchernikov, Kiev et Odessa, avant de remonter jusqu’à la Lituanie et ensuite dans les régions du Caucase. Les documents attestent qu’en juillet 1853 Léon Tolstoj l’a entendue jouer à Pjatigorsk. Après les journées triomphales à Grosny (Tchétchénie) où le prince Bariatinski, escorté de ses Cosaques, lui fait tous les honneurs, elle continue sur Novocherkassk, une ville du sud (non loin de la frontière ukrainienne) où sévit le choléra.

la cathédrale de l’Ascension de Novocherkassk (carte postale historique)
Lise Christiani y succombe quelques jours après son arrivée le 2 octobre 1853, à l’âge de 27 ans.

Le monument funéraire de la musicienne (dom. publ.)
Sous le titre « Voyage d’un Stradivarius » Alexandre Barbier, le grand-père et premier promoteur de notre virtuose, va lui consacrer plusieurs pages de feuilleton dans le Journal des Débats du 26 et 27 septembre 1860, en soulignant cette alliance entre la musicienne et son instrument « que rien ne devait plus dissoudre, hormis la mort. » Barbier s’applique à donner les détails de la trajectoire de la violoncelliste en Sibérie, comme p.ex. son passage à Tobolsk où « les sommités officielles même s’empressent atour d’elle ; elle est accueillie comme un oiseau chanteur, écho d’un printemps lointain, qui se serait égaré sous ce triste climat. Elle est applaudie pour ton talent, recherchée pour sa grâce et son esprit… » Quant à la mort de Lise il dit que « la fatale nouvelle n’en vint à sa famille que beaucoup plus tard (…). La guerre de Crimée ayant éclaté, le pauvre Stradivarius demeura prisonnier. »
L’instrument est cependant retrouvé et ramené à Paris par Edouard Thouvenel, un diplomate en résidence à Constantinople. Il repose actuellement dans une vitrine du Museo del Violino à Cremona, faisant partie de la collection Walter Stauffer. Il s’agit d’ailleurs d’un des premiers spécimens de Stradivari, aux dimensions légèrement plus grandes. Selon les spécialistes il s’agit d’un des plus précieux violoncelles du maître de Cremona.

le Stradivarius de 1700 de Lise Cristiani Accompagnée d’un luthier de Paris Sol Gabetta s’est rendue en 2024 à Cremona où le directeur du Museo del Violine a sorti de la vitrine ce fameux « violoncelle de Stradivarius à l’étiquette « Lise Christiani » pour qu’elle le fasse chanter dans la salle réservée à cet effet. – le 2 août 2024 elle a présenté avec un groupe de musiciens un programme ‘Lise Christiani’ au Festival Menuhin de Gstaad et son CD avec un programme ‘Lise Cristiani’ va sortir prochainement.
S O U R C E S :
Freia Hoffmann, Reiseberichte von Musikerinnen des 19. Jahrhunderts, Olms, Hildesheim 2011
Freia Hoffmann, Europäische Instrumentalistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts: «Christiani, Chrétien, Berbier, Lise, Lisa, Elise», Oneline-Lexikon des Sophie Drinker Instituts 2007/2010
Béla Pukanszky, « Cellist woman in a Paris salon ! » – Lisa Cristiani’s career as a performer in contemporary publicism, article sur internet, Eszterhazy Karoly Catholic University, Eger (Hongrie) 2021
Simone Jung, Mit dem Celle ans Ende der Welt (Sol Gabetta auf den Spuren von Lise Christiani), film documentaire sur arte, Allemagne 2024
-
Clara Haskil – silhouette fragile, pianiste géniale

Clara Haskil 1956 (photo Roger Hauert – © non repérable)
Née en 1895 dans une famille sépharade à Bucarest dont le père est originaire de la Moldavie Clara Haskil rivalise avec ses deux sœurs : Lili la pianiste et Jeanne la violoniste qui déclare un jour : « Nous avons du talent, mais Clara a du génie. » Après le décès de leur père Clara est prise en charge par son oncle Avram de Vienne. La fille de 7 ans y entend Josef Joachim et s’enthousiasme pour le violon, l’instrument qu’elle maîtrisera tout au long de sa carrière de pianiste.
Chaleureusement applaudie comme pianiste prodige à Vienne la petite Roumaine de 10 ans exécute des pièces sans partition et sans fautes après les avoir entendues une seule fois, et ceci dans n’importe quelle tonalité ! Elle est prise en main par le professeur Robert qui va la recommander à Gabriel Fauré à Paris.
Accompagnée par son oncle Avram elle réussit le concours d’entrée au Conservatoire de Paris où elle mène de front l’étude du piano – et du violon pour lequel elle remporte son 1er prix (pour le piano elle l’aura plus tard). Montée à la classe de virtuosité d’Alfred Cortot à 12 ans elle devra se contenter d’un enseignement de suppléance, le maître étant toujours absent.

Clara Haskil à Paris Malgré sa déception elle travaille avec acharnement et se prépare pour son 1er prix. La jeune virtuose de 15 ans va conquérir les salles en Italie, en Suisse et à Bucarest, grâce à un imprésario suisse. Lorsqu’elle joue la redoutable Chaconne (selon Bach) de Ferruccio Busoni à Zurich le compositeur lui offre son enseignement au Conservatoire de Berlin, Mais maman y oppose son « Njet », sa fille étant trop jeune pour ce genre d’aventure, si bien que l’offre de Busoni se réduit à un cours de maîtrise programmé à Bâle la même année.
Un séjour prolongé à Lausanne – toujours sous la tutelle de son oncle – lui ouvre de nouvelles portes : Le pianiste Ernest Schelling de Genève la présente à Paderewski et à l’éditeur et mécène G. Schirmer qui, l’ayant entendue jouer, lui propose des tournées en Amérique.
Mais la colonne vertébrale déformée ne supporte plus le buste de la jeune femme de 18 ans grandie trop vite. Un traitement s’impose. Dans une clinique normande on lui administre une camisole de plâtre, une mesure drastique qui l’éloignera pendant des années du piano. Clara ne supporte pas son armure, et un des docteurs lui enlève cet instrument de torture, sans que les vertèbres se soient redressées – la Haskil restera la pianiste maigrichonne et voûtée pendant toute sa vie.
Après la guerre elle va rattraper ses années perdues en clinique. A Paris elle réussit une rentrée triomphale avec le concerto no. 20 de Mozart, avant de se retirer à Amden en Suisse (au-dessus du Walensee) pour une cure de rétablissement, en compagnie de son oncle qu’elle vient de rejoindre à Zurich, après que ce dernier a passé des années comme prisonnier de guerre.

Le 2e mouv’t du concerto no. 20 (son Mozart favori, à côté du no. 3 de Beethoven), une mélodie comme transfigurée sous ses doigts…

Clara Haskil autour de 1920 Ces trois années dans le village alpin remettent la pianiste sur pied. Elle se sent de nouveau en forme pour donner un concert à Lausanne en 1921, son prochain domicile. Les nouveaux contacts avec le pianiste E.R. Blanchet et le compositeur G. Doret vont largement élargir son horizon. Doret annonce le récital de sa nouvelle amie en 1921 avec un article grandiloquent dans la presse genevoise, parlant de sa modestie, de sa perfection, de son dévouement à la musique etc…La salle à Genève est comble et l’enthousiasme du public sans bornes, aussi celui d’Ernest Ansermet qui n’hésite pas à engager Clara Haskil comme soliste du concerto de Schumann avec son orchestre à Vevey et à Neuchâtel.
C’est la période où la soliste élargit son réseau de contacts grâce à la bienveillance d’un mélomane de Vevey : le directeur de Nestlé Emile Rossier. Que ce soit Pablo Casals pour qui elle sera une fidèle partenaire comme chambriste pendant de longues années, que ce soit Georges Enescu, un ami de son pays, avec qui elle donnera plusieurs concerts, ou alors Eugène Isayë, le virtuose belge. Avec lui elle jouera toutes les sonates de Beethoven et sera même reçue par la Reine Elisabeth à Bruxelles. – Après une première tournée en Amérique elle retourne en Roumanie pour plusieurs concerts avant de rejoindre Paris où elle sera accueillie par la princesse de Polignac. Récitals et concerts se suivent à un rythme accéléré à Paris, en Belgique, en Suisse. Le séjour parisien lui occasionne la rencontre avec son compatriote Dinu Lipatti qui restera un ami intime pour toujours. Leur admiration mutuelle s’exprime par une riche correspondance pendant les années de la guerre.

Dinu Lipatti en 1950 La guerre et l’occupation allemande de la France du Nord contraint l’Orchestre National – dont Jeanne Haskil fait partie comme violoniste – de se transférer en zone libre. Clara a la chance de partir avec sa sœur et les autres musiciens. On passe la ligne de démarcation sans accroc pour arriver à Marseille, le refuge de nombreux juifs européens à l’époque. Le répit ne dure qu’une année : L’arrivée imminente des Allemands dans le Midi représente un nouveau danger. Grâce à des amis elle décroche un visa pour la Suisse, le pays qui a déjà fermé les frontières pour les réfugiés juifs. Le dernier train de la veille de l’arrivée des Allemands à Marseille la ramène à Genève, échappée de justesse !
Clara Haskil a 47 ans. En convalescence après l’opération à Marseille d’une tumeur cérébrale elle retrouve son havre de paix à Vevey, d’abord chez des amis qui lancent un fundraising en sa faveur. Empêchée au départ par la loi suisse de poursuivre une activité professionnelle elle va travailler son piano dans une magasin d’instruments et on lui organise un récital privé où viennent l’écouter quelques notoriétés de la région comme Hugues Cuénod ou Igor Markevitch, et Nikita Magaloff de s’enthousiasmer : « Chez aucun de mes collègues (…) j’ai senti cette incroyable légèreté, cette assurance sans contrainte qui fait éclater la musique de façon spontanée et naturelle. » Avec l’orchestre de Pierre Colombo de Vevey elle exécute en 1944 le double concerto de Mozart à côté de Magaloff. Ce dernier se souviendra du triomphe et comment il a ‘découvert’ ce concerto grâce au jeu sublime de sa partenaire, ce qui les a conduits à jouer en public d’autres œuvres pour deux pianos, voire même la sonate avec batterie de Béla Bartok ! Clara, la ‘Mozartienne’, note dans son journal : « Je travaille sans arrêt. Plus on pénètre dans la musique de Bartok, plus on se rend compte qu’on n’y connaissait rien. » Sur le plan de la vie privée les retrouvailles avec la famille Rossier s’avère salutaire. Depuis Vevey elle allonge ses antennes vers la Suisse allemande : Le mécène Dr. Reinhart de Winterthur, qui avait déjà entendu la Haskil de 16 ans, la met en contact avec des musiciens de marque comme les violonistes Peter Rybar et Aida Stucki (la future professeure d’Anne Sophie Mutter !) le quatuor de Winterthur et la pédagogue Anna Langenhahn de renommée internationale domiciliée au château de Berg en Suisse orientale.
Un autre hasard veut qu’elle retrouve Dinu Lipatti domicilié actuellement à Genève. Avec lui elle exécutera le double concerto de Mozart, mais leurs moments de bonheur commun sont comptés : Lipatti ne vaincra pas son cancer Hodgkin et mourra en 1950.
L’année 1949 représente un tournant dans la vie de l’artiste. Avec la citoyenneté de Vevey et son passeport suisse elle accède plus facilement aux salles internationales. Dinu Lipatti l’en félicite en lui dédiant un nocturne et un poème humoristique. Michel Rossier, le successeur de son père comme directeur de la société « Arts et Lettres » restera un appui inestimable pour Clara Haskil, son imprésario inofficiel, mais aussi son coach qui tâche de lui faire surmonter les éternels doutes et le terrible trac avant ses entrées en scène. – Elle s’installe maintenant dans un appartement à elle et s’offre son premier piano à queue. De plus elle invite sa sœur Jeanne – échappée de justesse aux rafles à Marseille et retournée en Roumanie – de venir la rejoindre à Vevey. La vie en commun avec elle lui donne une sorte de cocon familial et Jeanne accompagne souvent Clara lors des tournées.
Quant à son calendrier Clara ne sait bientôt plus où donner de la tête. Ce n’est que depuis son retour définitif en Suisse que sa carrière internationale prend son vrai élan. Avec Hermann Scherchen elle joue le concerto de Schumann à Winterthur et le no. 2 de Chopin à Berne. Werner Reinhart lui offre un séjour de vacances à Pontresina et à Sils-Maria en Engadine où l’on se retrouve entre amis : Szigeti, Magaloff, Menuhin, Lipatti, Fournier, Klemperer, P. Sacher….

avec Géza Anda et Herbert von Karajan 1955 à Lucerne (©ledeblocnot.com)
Les stars de la baguette courtisent la faible petite silhouette, et sur le podium elle fait montre d’une vigueur quasi titanesque, ne jouant pas seulement Mozart qu’elle maîtrise avec son toucher cristallin, mais tout aussi bien les « poids lourds » du répertoire romantique (le no. 2 de Brahms appris par cœur en deux jours !). En dehors de ses engagements à Paris, en Hollande ou en Italie elle donne de nombreux concerts en Suisse, y compris des enregistrements radiophoniques dont Lipatti lui envoie un écho enthousiaste. Dans une lettre du 24 août 1949 de Zurich elle parle de ses voyages à Lucerne, Winterthur et Coire, de son travail quotidien avec Pablo Casals et qu’elle va l’accompagner à Zermatt où il donne chaque année des cours de maîtrise. Clara le rejoindra l’année suivante à Prades où elle trouvera le partenaire le plus important dans sa vie de chambriste : Arthur Grumiaux.

récital avec Casals à Prades 1953 Ferenc Fricsay, domicilié en Suisse, est l’un des chefs d’orchestre auquel la Haskil se sent particulièrement attachée. Leurs concerts et les enregistrements sont nombreux, et Fricsay s’en souviendra après la mort de son amie : « Je ne connaissais pas de partenaire plus attentive et agréable qu’elle. Comment elle a accepté humblement toute proposition bien qu’elle ait eu les meilleures idées elle-même. Il y a peu d’orchestres réputés en Europe avec lesquels nous n’aurions pas joué ensemble, et tous les musiciens l’ont portée dans leur cœur. »
Entre 1952 et 1960 ses séjours à Vevey sont de courte durée. Elle est sollicitée par tous les pays d’Europe et une tournée en Amérique comble ses triomphes. A Boston elle remporte des triomphes avec le 3e concerto de Beethoven – et le jeune pianiste Eugène Istomin prend soin d’elle lors de ce séjour, si bien qu’il se fait apostropher de « Mére de Haskil » par son ami Gary Graffmann. Un jour il emmène Clara chez les Horowitz, une soirée mémorable dont elle se souvient : « Milstein lui a parlé de moi (…) et nous sommes restés jusqu’à deux heures du matin. Au piano Horowitz est Satan en personne, mais très aimable. » – Quant aux amitiés en Suisse qui comptent elle trouve les meilleures détentes dans la villa de la famille Chaplin au-dessus de Vevey. Chaplin l’invite à table et lui offre un Steinway dans sa villa. C’est là où on la voit rigoler, elle d’habitue si sombre, sinon angoissée:

rigolade avec Chaplin, Oona à la caméra
Chaplin a tellement admiré son jeu qu’il a dit un jour : « Dans ma vie j’ai rencontré 3 génies : Einstein, Churchill… et Clara Haskil. »
Les années 1958 et 1959 sont chargées d’engagements dans toute l’Europe – pour une pianiste de santé si fragile ! Heureusement que ses deux sœurs Jeanne et Lilly lui sont dévouées. Clara se sent auprès d’elles en sécurité, tout en se rebellant par moments contre leurs avertissements autoritaires, ayant horreur d’un repos trop long, de « gaspiller le temps » comme elle dit.
En 1958 une sérieuse pneumonie la retient plus longtemps à Paris. Michel Rossier court la rejoindre et les docteurs réussissent petit à petit à la remettre sur pied. On lui permet toutefois de retourner en Suisse et de jouer à partir de l’été. Le 25 mai elle est ramenée à Vevey dans la voiture de Chaplin, en vue du concert avec Géza Anda du 16 août à Lucerne : ce double concerto de Mozart est repris en 1959 sous la direction de Joseph Keilberth – un succès bien mérité, après quoi elle se met à planifier ses prochains concerts. Les séjours à Vevey vont donc se raréfier. – Keilberth dira plus tard : « Les concerts avec elle me resteront inoubliables…elle jouait avec un dévouement comme si tout cela allait de soi, sans peine… »
La chute mortelle sur un escalier de Bruxelles le 7 décembre 1960 – où elle arrive la veille d’un récital avec Grumiaux – déclenche un choc dans le monde musical.

Arthur Grumiaux avec sa partenaire
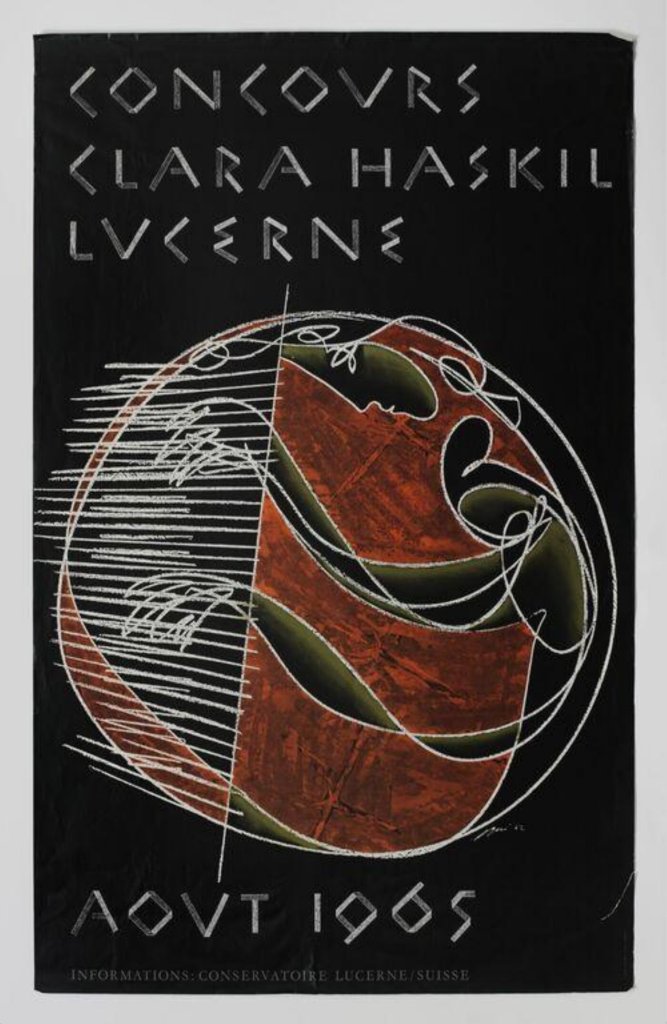
Le CONCOURS CLARA HASKIL fondé en 1963 par Michel Rossier et les amis de la pianiste initié à Lucerne se tient tous les deux ans à Vevey, un concours aux antipodes de celui de Varsovie : Ici l’on ne distingue pas la virtuosité, mais la profondeur de l’interprétation dans l’esprit de Clara Haskil. Son premier lauréat : Christoph Eschenbach, en 1965.
S O U R C E S :
Rita Wolfensberger, Clara Haskil, Alfred Scherz-Verlag, Berne 1962
Jérôme Spycket, Clara Haskil, Hallwag Verlag, Berne 1977
Jérôme Spycket, Clara Haskil – Album-Photos, Verlag NZZ, Zurich 1984
affiche du concours 1925 par Hans Erni (©Harry R. Beard Coll.)
D I S C O G R A P H I E :
à part les nombreux CDs avec les œuvres de Mozart et de Schumann on recommande le coffret DECCA de 2010 avec les œuvres de Scarlatti, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, de Falla, Ravel
-
Fanny Hensel-Mendelssohn Bartholdy – virtuose et compositrice à l’ombre de son frère

Fanny Hensel-Mendelssohn Bartholdi à 37 ans (dom. publ.)
Dans la famille d’Abraham Mendelssohn venue de Hambourg en 1810 le planning quotidien est de rigueur : les enfants Fanny, Felix et Paul suivent un régime de leçons et d’études qui ne tolère pas de sursis. Ils sont enseignés par des précepteurs de prestige dans les langues, les sciences, la religion et le dessin (dont profite surtout Felix), à part leur enseignement du violon et du piano, sans parler de la composition dispensée par C.F. Zelter, la figure de proue en matière de théorie à Berlin et un ami de longue date de papa. Les progrès pianistiques de Fanny sont stupéfiants. A 13 ans elle joue pour son père tous les préludes du ‘Clavecin bien tempéré’ par cœur, ce qui déclenche des reproches de la part de tante Henriette à l’adresse de son frère, comme quoi il risquerait de surmener sa fille. Zelter accueille les enfants au chœur de la Singakademie, le lieu où l’on exécute les vieux maîtres du baroque. Les œuvres de Bach figurent toujours au hit parade du Berlin de l’époque grâce à la présence de ses fils Carl Philipp Emanuel et Wilhelm Friedemann, mais aussi grâce à Christian Friedrich Fasch, le prédécesseur de Zelter, formé dans la tradition de Bach. – Fanny et Felix se divertissent en rivalisant avec leurs premières compositions. On commence une pièce et en cours de route on échange les feuillets pour la finir. Leur style se ressemble à tel point – encore plus tard – que sur le plan du piano les deux idiomes ne se laisse guère distinguer.
Quant à briller comme pianiste en public Felix passe avant sa sœur aînée. C’est que les parents évitent de suggérer à leur fille l’envie d’une carrière, nonobstant leur conviction qu’elle a droit à un enseignement à large échelle. Fanny ne se morfond point de voir jouer son petit frère de 10 ans sur scène, sachant que pour elle, bien que virtuose, la musique reste du domaine privé, tel le dictum ‘bienveillant’ de son père : « Pour Félix la musique sera probablement sa vocation, tandis que pour toi elle ne sera qu’un ornement, mais jamais le fondement de ton être et de ton agir. » La culture humaniste et musicale en famille se développe à l’ombre d’un antisémitisme ambiant, si bien qu’un jour les parents ont opté pour la conversion luthérienne. Abraham s’appuie toutefois dans son éducation sur le pilier juif de l’obéissance hérité de son père, le philosophe illuministe Moses Mendelssohn, et sur le pilier protestant de la conscience.
En 1822 on part pour un voyage de plusieurs mois en Suisse où la fille de 17 ans ne cesse de s’extasier face au panorama alpin et aux sites lacustres. Arrivée au seuil de l’Italie elle attrape le virus de cette fameuse ‘nostalgie italienne’ déclenchée par le livre de Goethe (Italienische Reise) quelques années avant. Lors d’une visite à Weimar Fanny suscitee l’admiration du grand Goethe avec ses interprétations de Bach et ses compositions sur les poèmes du maître.
Un des points tournants de 1821/22 est la rencontre avec le peintre Wilhelm Hensel lors d’une exposition de ses tableaux – un péril aux yeux de la mère Lea : l’homme serait trop âgé (28 ans) et – par-dessus le marché -caresserait l’idée de se convertir au catholicisme ! Ayant obtenu une bourse d’étude Hensel séjournera à Rome pour quelques années. Problème ajourné ! On se jure la fidélité et Fanny se lance dans les programmes des « Musiques de dimanche » initiées par son père. Le répertoire de ces concerts privés est dominé par J.S. Bach, mais on y joue aussi du Mozart du Gluck, du Beethoven et les œuvres des deux Mendelssohn. Fanny (piano et direction), Felix (piano, violon et direction) et Paul (violoncelle) réunissent autour d’eux des musiciens berlinois pour offrir aux invités des programmes variés.
Quant aux œuvres de Fanny (env. 450) il s’agit d’abord d’une série de Lieder avec accompagnement du piano sur les poèmes de Goethe, de Heine et de divers poètes romantiques. On y diagnostique du premier coup d’œil son intention de s’offrir comme pianiste le podium d’un jeu perlé aux arpèges, comme p.ex. dans cette ‘barcarole’ op. 1 no. 6 :

Pendant que Felix (âgé de 13 ans) se penche sur son 1er concerto pour piano en la mineur et son 1er quatuor pour piano et cordes op. 1 sa sœur Fanny finit son propre quatuor avec piano qui ressemble au millimètre près à celui de son frère composé en même temps : Qui a inspiré qui ? Les montagnes russes de ces gammes et arpèges qui déferlent à l’octave dominent les mouvements rapides dans les deux quatuors, où les trois cordes ont tout juste droit à des noires, voire des blanches pour préserver le rythme et pour marquer la charpente harmonique :

passage du 1er mouvement du quatuor de Fanny
A part les 4 accords initiaux pilonnés avec vigueur par tous les partenaires le 1er mouvement déroule le tapis rouge pour le piano avec un enchaînement de doubles croches qui se propagent tout au long de la portée, et le choix du la-bémol majeur, peu convivial pour les cordes, est un cadeau pour le pianiste. Après un larghetto à caractère dansant et un menuet peu inspiré les bourrasques des gammes au piano reprennent de plus belle dans le 12/8 du presto final. – C’est la période où la communauté mendelssohnienne estime le niveau pianistique de Fanny supérieur à celui de Felix, bien que ce dernier passe pour un enfant prodige.
Les leçons de Zelter, basées en majorité sur les œuvres de Bach, permettent à Fanny de progresser à vue d’œil (du moins selon les lettres de Zelter adressées à Goethe). En même temps Fanny et Felix se confient au pianiste Ignaz Moscheles, de passage à Berlin en 1824, qui ne retient pas son admiration pour Fanny : « …elle aussi infiniment douée joue par cœur des fugues et des passacailles de Bach avec une précision admirable. »

L’emménagement de la famille dans une vaste demeure au no. 3 de la Leipzigerstrasse en 1825 (aujourd’hui le siège du Bundesrat) ouvre de nouvelles perspectives : L’immeuble dispose d’un parc avec son « Gartenhaus » qui peut accueillir jusqu’à 150 auditeurs. Fanny et Felix y poursuivent la tradition des « Musiques de dimanche » pendant la saison hivernale (au chauffage insuffisant: on s’y accomode tout en grelottant !), et en été les rangs du public s’étendent jusqu’aux allées du parc. On compte jusqu’à 300 personnes venues écouter l’oratorio « Paulus » de Felix en 1837. Ce public se compose d’une part du réseau familial élargi et des notoriétés académiques d’autre part. On y voit surgir p.ex. les deux géants de l’esprit allemand : Alexander von Humboldt et G.W.F. Hegel, mais aussi Rahel Varnhagen ou le poète Heinrich Heine, sans parler des musiciens cotés comme Ignaz Moscheles.

le pavillon du jardin (W. Hensel, dom. publ.) 
plaque à la Leipzigerstrasse 3
L’atmosphère dans ce pavillon est imprégnée d’humour et on s’amuse à publier un périodique nommé « Gartenzeitung », une feuille pleine d’anecdotes, de poèmes et de dessins. Ce nouveau décor inspire à Félix son fameux Octuor pour cordes op. 20 ainsi que l’ouverture du Songe d’une nuit d’été, pendant que Fanny se permet d’aller écouter les cours de philosophie donnés par Hegel, un geste à attribuer à l’émancipation progressive de la femme dans le monde académique, mais la gent féminine n’y est admise que comme auditrices libres, risquant en outre de s’exposer aux railleries de la part des messieurs.
Un jour Fanny va taquiner son frère Paul en lui dédiant son Capriccio dont la partie du violoncelle ressemble à la portée des violoncelles tutti dans une symphonie : des notes alignées en profondeur et d’un niveau élémentaire, parsemées toutefois de quelques ascensions succulentes mais périlleuses dans les aigus, le tout dans un là-bémol majeur – quel supplice ! La pianiste, par contre, s’offre un festin avec ses cabrioles destinées à mettre le partenaire à l’ombre.
Les activités des « Musiques de dimanche » s’intensifient, malgré les absences de Felix souvent en tournée. Fanny, curieuse des aventures de son frère à l’étranger lui demande tous les détails dans ses lettres, tout en soulignant les inconvénients de sa réclusion à Berlin. Mais elle compose sans discontinuer : Mélodies, lieder, pièces pour piano, même des cantates (Job, Les morts du choléra de 1831). Quant à l’œuvre pour piano il y a lieu de retenir les deux sonates en do-mineur et en sol-mineur, mais avant tout le cycle intitulé « L’Année » (Das Jahr), 12 pièces ‘à programme’ inspirées de la nature changeante au cours des 12 mois – un clin d’œil aux « Quatre Saisons » de Vivaldi ou à celles de Haydn ? – Après l’allure éléphantesque des pas dans la neige profonde, accompagnés d’arpèges sauvages pour la bourrasque de flocons dans Janvier le caractère ‘saltando’ de Février figure une agitation carnavalesque par la course époustouflante d’un 6/8 qui, par une joyeuse gambade qui se mue en une trépidation fracassante aux octaves de tonnerre. Le printemps (Mars) s’annonce par une pièce du genre « Lied ohne Worte » de Felix, très chantant, qui débouche sur les variations sur le choral de Pâques « Christ ist erstanden » (le Christ est ressuscité). – La suite de ce cycle embrasse toutes les émotions que suscitent les saisons: de l’amabilité des chansons printanières (Avril/Mai) aux marches et danses en plein air (Août) et aux sérénades du soir (Juin/Juillet), de la barcarole au bord de la rivière (Septembre) au scintillement des doubles croches aiguës qui préparent le terrain pour le choral de la nativité « Vom Himmel hoch… » (du haut des cieux…) avec ses variations (Décembre). Dans ces 12 morceaux nous rencontrons fréquemment l’enchaînement d’accords diminués dans les passages transitoires comme p.ex. ces mesures dans Mai :

Quant à l’articulation nous avons d’une part le jeu perlé des arpèges typiquement mendelssohniens, d’autre part des enchaînements d’accords pilonnés ou d’octaves martelés non loin des Impromptus de Schubert.
Après les noces et une fausse couche en 1832 Fanny se retire de la Singakademie pour donner à ses ‘Musiques de dimanche’ un nouvel essor avec des programmes très variés : des œuvres vocales, des ouvertures, de la musique scénique, des cantates, un oratorio biblique.
Et qu’en est-il du quatuor à cordes, la pièce de résistance de tout compositeur après Haydn ? Fanny s’y risque en 1834, une entreprise qui semble lui donner du mal. Le coup de maître ne veut pas lui réussir, ce que Felix lui fait gentiment comprendre dans une lettre. Son quatuor reste un amalgame quelque peu hétéroclite de pièces éparses : L’Adagio introductif avec une cellule thématique du genre ‘prière’ est suivi d’une danse aux pieds légers d’un 6/8 (Allegretto) où, au cours de la fugue trépidante (qui rappelle la finale de l’octuor de Felix) le violoncelle est propulsé sur ses doubles croches dans le grave de sa tessiture. La Romance suivante s’annonce par des fragments mélodiques charmants, tout en se perdant par la suite dans un déroulé mécanique. Quant à l’Allegro molto vivace (12/16) le discours allègre reprend le dessus, dominé par un engrenage de gammes à l’unisson, escalades ou dégringolades se relayant entre les registres et au-dessus desquelles plane toutefois une atmosphère joyeuse, suscitée par les cantilènes du 1er violon.
Si les prouesses pianistiques de Fanny ne dépassent pas le périmètre de la Leipzigerstrasse 3, la bonne société lui occasionne une seule entrée sur scène en salle de concert : avec le 1er concerto pour piano en sol-mineur de Felix dans un concert de bienfaisance en 1838 – la ‘bonne cause’ étant la seule légitimité pour la musicienne de se produire en public. Dans la lettre du lendemain à son frère elle parle d’un « concert ignoble, voire horrible », vu la salade mixte du programme et le dilettantisme des autres musiciens.
L’année 1839 va enfin combler son vieux désir d’un voyage en Italie, un séjour d’une année avec son mari et leur enfant. A Vérone, Rome et Naples elle fait preuve de solides connaissances sur l’antiquité et son bonheur ne connaît pas de limites : « Je suis incapable d’exprimer mon bonheur indescriptible, je me retrouve dans un état d’âme toujours euphorique… ». A Rome Hensel introduit son épouse auprès des boursiers de la Villa Medici

la villa Medici à Rome où les festivité de tout genre la mettent en extase et où excelle comme pianiste, sans parler de l’heureuse rencontre avec Charles Gounod. Dans son journal elle le décrit comme « un artiste brûlant d’une flamme juvénile ». Et plus loin elle raconte : « S’il fait clair de lune, on part en bande vers les bois ou vers le Forum et le Colisée. Gounod grimpé sur un acacia nous jette des branchages fleuris. Nous entonnons en chœur un concerto de Bach et marchons en cadence à travers Rome ».
Un des derniers triomphes de la compositrice est certainement l’œuvre terminée au printemps 1847: son Trio en ré-mineur op. 11 créé le 11 février. La critique y voit de nombreuses références aux trios de la même tonalité de son frère et de Robert Schumann, en partie aussi aux symphonies de Beethoven (surtout la 7ème). Les élans d’exubérance du 1er ou du 4e mouvement ne sont que l’encadrement d’un Lied placé au centre qui figure comme noyau thématique de l’ensemble du trio, avant que les broderies d’arpèges vertigineux caractérisent la finale comme ‘pièce de concert’ pour le piano escorté des deux instruments à cordes.
Fanny Hensel-Mendelssohn est au faîte de sa carrière comme animatrice des ‘Musiques de dimanche’ : elle s’est profilée comme pianiste, comme compositrice et à la baguette.
Le 14 ai 1847 elle dirige, installée au piano, une répétition de « La Nuit de Walpurgis » de Felix, selon d’autres sources, mais peu probables, il s’agirait d’une propre composition sur « Faust » de Goethe. Un malaise passager (engourdissement dans les doigts) est suivi d’une attaque cérébrale qui va la terrasser au bout de quelques heures.
Séjournant à l’étranger Felix est comme abattu par la nouvelle. Le requiem pour sa sœur : son 6e quatuor en fa-mineur, une œuvre pénétrée de deuil et de rage. Il succombera encore la même année en novembre, lui aussi à une attaque cérébrale, l’âge de 38 ans.

la pierre tombale de Fanny, à côté des autres membres de la famille Mendelssohn – au cimetière de la Trinité de Berlin S O U R C E S :
Françoise Tillard, Fanny Hensel née Mendelssohn Bartholdy, éd. Symétrie, Lyon 2007
Peter Schleuning, Fanny Hensel geb. Mendelssohn, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2007
Thea Derado, Fanny Mendelssohn Hensel – aus dem Schatten des Bruders, Verlag E. Kaufmann, Lahr 2005
Martina Bick, Musikerinnen in der Familie Mendelssohn, Hentrich Verlag, Berlin 2017
DISCOGRAPHIE / YOUTUBES:
Gondellied: Ran Lao (soprano) + Micaela Gelius (piano) – extrait de Fanny Hensel, Lieder (CD arte nova classics – youtube/audio)
Quatuor pour piano et cordes + Trio op. 11 : Kaleidoscope Chamber Collective (CD Chandos 2021 – youtube/audio) – plusieurs films du trio
Capriccio : Penelope Lynex (violoncelle) + Alexander Wells (piano), CD (LIR Classics – youtube/audio)
Das Jahr (L’Année) : Anna Kienast (youtube/audio)
Lauma Skride (CD Sony 2007 – youtube/audio)
Laurence Manning (youtube 2018 Montreal/film)
Quatuor à cordes : Quatuor Selini (youtube 2022 Meran/film)
Quatuor Hadelich (youtube 2023 au Canada/film)
Quatuor Nadelman (youtube 2021/film)
Quatuor Fanny Mendelssohn (youtube 2022/audio
avec partition synchronisée)
-
S'abonner
Abonné
Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.